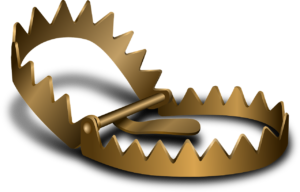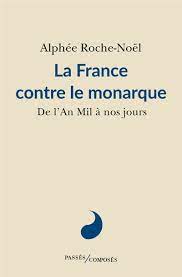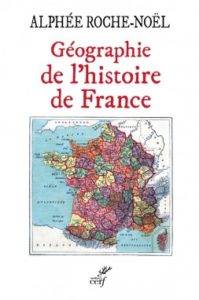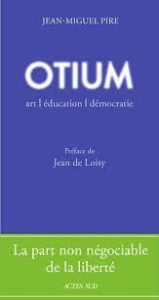 L’« otium » désigne « un temps affranchi des tâches vitales, des préjugés, des calculs, des croyances, notamment religieuses, et des intérêts ». Ainsi mon ami Jean-Miguel Pire définit-il la notion dont il nous donne, dans son essai paru début 2020*, une précise généalogie, d’Athènes et Rome qui forgèrent le loisir studieux, jusqu’à notre époque, qui lui préfère le negotium, c’est-à-dire le « nec otium » – en passant par Montaigne, Condorcet, Guizot, Valéry, Arendt, Malraux…
L’« otium » désigne « un temps affranchi des tâches vitales, des préjugés, des calculs, des croyances, notamment religieuses, et des intérêts ». Ainsi mon ami Jean-Miguel Pire définit-il la notion dont il nous donne, dans son essai paru début 2020*, une précise généalogie, d’Athènes et Rome qui forgèrent le loisir studieux, jusqu’à notre époque, qui lui préfère le negotium, c’est-à-dire le « nec otium » – en passant par Montaigne, Condorcet, Guizot, Valéry, Arendt, Malraux…
Lorsque ce livre est paru, nous ne savions pas que le monde soudain s’arrêterait de tourner, voire de tourbillonner, créant la potentialité de ce temps de pause qui peut être, lorsque certaines conditions matérielles sont réunies, celui du loisir studieux et fécond. Pire a assumé d’inscrire son travail dans l’histoire des idées ; nous le voyons ici, par la force des événements, réencastré dans la matérialité de l’existence. C’est là du reste qu’il déploie tout son sens, car il se veut, se présente et se pense comme un manifeste démocratique. Philosophie et démocratie ne sont-ils pas les « fruits de cette faculté inédite reconnue aux individus de réfléchir à loisir sur toute chose en vue de se construire et de contribuer au bien commun » ?
L’arbre généalogique de l’otium commence non pas aux Latins qui lui donnèrent son nom, mais à la skhôlè grecque, à la fois préhistoire et idéaltype. Dans une société esclavagiste, donc, où le loisir de quelques-uns, des citoyens, cette sorte de vie noble de l’Antiquité, est permise par le labeur de beaucoup. Dès sa genèse, dès qu’il eut été conçu comme une sorte d’accomplissement de la vie civique et humaine – ce sont mes mots, et non pas ceux de Pire – le loisir studieux fut par conséquent arrimé à un système social particulièrement inégalitaire et inhumain. L’esclavage – légal – a disparu sous nos latitudes, mais le problème de l’accès de toutes et tous à l’otium demeure, dans une société où la division du travail distingue encore de facto ceux qui pourront se consacrer au loisir fécond et ceux chez qui les publicitaires et autres vendeurs de mirages iront essentiellement chercher, selon la formule répugnante de Le Lay rapportée par Pire, du « temps de cerveau disponible ».
Après avoir franchi les siècles « à sauts et à gambades » pour reprendre les mots d’un Montaigne dans lequel l’auteur voit l’un de ceux qui ont retissé le fil entre l’Antiquité et la modernité, la possibilité d’une « politique de l’esprit » apparaît avec – et sous – François Ier. Au préfigurateur de l’absolutisme, homme des guerres d’Italie, massacreur, par procuration, des Vaudois, initiateur de la politique d’intolérance que Henri II et ses successeurs porteront à son paroxysme, il faut faire ce crédit d’avoir été l’ami des arts et des lettres, et d’avoir singulièrement œuvré à leur développement sous l’influence bénéfique des humanistes, à commencer par Budé, notamment en instituant le Collège royal, futur Collège de France. Plus certainement, la vision d’une politique de l’esprit proprement démocratique sera esquissée pendant le siècle des Lumières, dans les sociétés de pensée, et pendant la Révolution, notamment – et exclusivement ? – par l’admirable Condorcet. Mais, sautons encore par-dessus les lustres.
Comme attendu, Jean-Miguel Pire, qui a fait sa thèse sur Guizot, consacre le temps qu’il faut à la monarchie de Juillet. Cela tombe bien, car les près de deux décennies du règne de Louis-Philippe forment, du point de vue des effets de la politique de l’esprit sur la population et la société, une période des plus édifiantes, non exempte de paradoxes fructueux. « C’est la première fois qu’un régime politique lie sa légitimité à l’extension des Lumières dans toutes les strates de la société », écrit Pire. À raison, en ce sens que la Ire République, celle de la Convention comme celle de Thermidor, avait seulement dessiné l’épure, posé des jalons, significatifs, cependant, dans un temps où, il est vrai, les périls étaient partout et où les priorités (institutionnelles, financières, militaires) ne manquaient pas. Ainsi, la loi Guizot de juillet 1833, prescrivant à toutes les communes de plus de 500 habitants de créer une école de garçons – puis également de filles à partir de 1836 – est la mesure la plus emblématique d’une politique dont les effets sur la société française seront absolument considérables, faisant passer l’analphabétisme de la moitié à un peu plus du tiers de la population masculine en l’espace de quinze ans. En France et ailleurs, des contemporains, socialistes, anarchistes – que l’on pense à Stirner, à Proudhon – contesteront, non sans motifs, le bourrage de crâne des écoliers d’alors ; il n’en demeure pas moins que pour se faire sa propre opinion, critique, sur la propagande scolaire, il faut commencer par savoir lire.
D’où vient, en tout cas, que Guizot, qui avait si intimement lié la pensée et le savoir à l’émancipation individuelle, ait si peu mesuré le risque que courait le régime des Orléans à laisser 8 millions de « citoyens » à la porte du droit de Cité ? (Pour ne parler que des hommes…) Jean-Miguel Pire ne néglige pas ce paradoxe lorsqu’il pointe « la grande inconséquence d’un régime qui, démocratisant l’accès au savoir et offrant à tous les moyens de critiquer la domination, s’est refusé à accomplir la démocratie en n’instituant pas le suffrage universel. » Il dit aussi : « à certains égards, la Révolution de 1848 balayant le régime est la conséquence de l’élévation du niveau d’éducation [que Guizot] avait lui-même organisée. » Et sur ce point non plus il ne semble pas qu’on puisse lui donner tort.
À ceci il faudrait ajouter que depuis que la révolution de la rue, celle des Trois glorieuses, avait été transformée en révolution de palais par l’opération de Thiers et consorts, un autre mouvement s’était formé dans les entrailles de la société. Parmi les deux millions d’ouvriers qui allaient chercher, dans les sociétés de secours mutuels, dans les réunions politiques, dans la lecture – et l’écriture – de journaux, l’espérance d’une vie meilleure, la conscience de classe se développait, inarrêtable. Dans ce temps où la sidérurgie, les mines, les filatures employaient parfois quinze heures par jour, consommaient jusqu’aux enfants, l’otium, c’est sûr, n’existait pas, ou de façon si marginale. Mais la réduction du temps de travail, mais l’instruction gratuite et laïque, revendications portées par les républicains – officieux – d’alors contenaient en germe ce rêve, bientôt en voie de réalisation, d’une société plus juste, où les savoirs – en même temps que les richesses – seraient également répartis. Chavirée par le parti de l’ordre, noyée par Boustrapa, la IIe République ne donna à ce programme qu’un commencement d’exécution. La Commune tenta, avec vigueur, de le mettre en œuvre – mais je me situe ici très au-delà des frontières du livre recensé. La IIIe République radicale eut plus de succès en menant les réformes que l’on sait et Pire ne la croit pas exempte de reproches, trouvant déjà dans sa politique d’instruction publique une orientation mercantile, une hostilité à l’éducation artistique, qui aura cependant vocation à devenir, bien plus tard, à la faveur de 68 et à travers l’histoire des arts, l’«atelier de l’otium dans la société ».
Au total, Otium ne propose pas seulement une généalogie dans l’histoire des idées : il dessine une ligne d’horizon dans l’histoire de la société et de l’individu. Un horizon d’émancipation, à n’en pas douter, dont nous avons pu collectivement nous rapprocher ou nous éloigner, selon les périodes, et qui peut aujourd’hui apparaître comme un ferment de résistance « contre l’hégémonie du négoce ». En ce sens, le livre de Jean-Miguel Pire est beaucoup plus révolutionnaire qu’il ne se proclame. Il n’a d’ailleurs pas besoin de trop en dire : sa seule conclusion est un manifeste et je ne résiste pas à l’envie de la citer : « [ce que les Athéniens réservaient] à un petit nombre doit désormais être le bien de tous. Quelle que soit la dureté de sa condition morale et matérielle, nul ne peut être privé d’une ressource qui demeure sa meilleure chance d’émancipation. Dans une vie, une année, une journée, une heure, chaque femme, chaque homme, doit pouvoir penser ce qui lui arrive avec tous les moyens de son imaginaire, de sa sensibilité et de sa singularité. L’État de droit ne peut mériter son nom s’il ne ménage pas à chacun un accès à l’otium, c’est-à-dire, au fond, la possibilité d’exprimer ce que peut être une vie humainement vécue. »
Pour atteindre cette fin, il est nécessaire de repenser l’organisation du travail, aussi vrai qu’une réflexion sur l’otium ne peut être séparée d’une réflexion sur l’organisation sociale qui, par-delà l’égalité des droits, le permet ou l’interdit dans la pratique. C’est la raison pour laquelle je voudrais sur ce point proposer un complément à la pensée de Jean-Miguel Pire, en citant, en conclusion de ce propos sur son excellent essai, le Catéchisme révolutionnaire de Michel Bakounine : « Lorsque l’homme de science travaillera et l’homme du travail pensera, le travail intelligent et libre sera considéré comme le plus beau titre de gloire pour l’humanité »**. Je ne crois pas que l’auteur renierait cette filiation qui me semble évidente.
*Otium, art, éducation, démocratie, Paris, Actes Sud, 2020.
** In Daniel Guérin, Ni Dieu ni maître, Anthologie de l’anarchisme, Paris, La Découverte, 2012 [1970].







 Peu après la mort de George Floyd et la manifestation du 2 juin place de la République,
Peu après la mort de George Floyd et la manifestation du 2 juin place de la République,  politique ponctuelle, si vertueuse soit-elle, ni même une réforme d’ensemble, qui y mettra un terme, si l’on ne rediscute pas dans un même mouvement les règles de notre société politique: comment on casse la verticalité du pouvoir pour lui substituer une association plus intime et constante de la population, comment les gouvernants et les fonctionnaires rendent des comptes sur leur action, etc. À ce propos justement, le 28 novembre, j’avais avec moi une pancarte qui disait, au recto : « Qui veut une police pour le peuple exige un gouvernement par le peuple » ; au verso : « 6e République, maintenant ».
politique ponctuelle, si vertueuse soit-elle, ni même une réforme d’ensemble, qui y mettra un terme, si l’on ne rediscute pas dans un même mouvement les règles de notre société politique: comment on casse la verticalité du pouvoir pour lui substituer une association plus intime et constante de la population, comment les gouvernants et les fonctionnaires rendent des comptes sur leur action, etc. À ce propos justement, le 28 novembre, j’avais avec moi une pancarte qui disait, au recto : « Qui veut une police pour le peuple exige un gouvernement par le peuple » ; au verso : « 6e République, maintenant ».