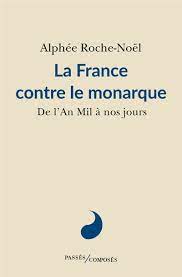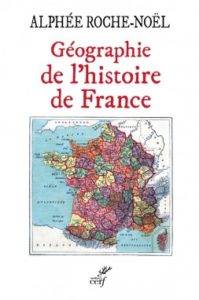Peu après la mort de George Floyd et la manifestation du 2 juin place de la République, je parlais sur ce blog des violences policières comme d’un problème démocratique au sens large. La suite n’a fait que me convaincre un peu plus dans cette voie, à commencer par l’arrivée, comme un cheveu sur la soupe, de la proposition de loi dite Sécurité globale. Ce texte en effet met en évidence deux intérêts contradictoires : l’intérêt du pouvoir à cacher certains faits ; l’intérêt du peuple à les dévoiler.
Peu après la mort de George Floyd et la manifestation du 2 juin place de la République, je parlais sur ce blog des violences policières comme d’un problème démocratique au sens large. La suite n’a fait que me convaincre un peu plus dans cette voie, à commencer par l’arrivée, comme un cheveu sur la soupe, de la proposition de loi dite Sécurité globale. Ce texte en effet met en évidence deux intérêts contradictoires : l’intérêt du pouvoir à cacher certains faits ; l’intérêt du peuple à les dévoiler.
Les choses cependant ne se sont pas exactement passées comme le gouvernement l’espérait. Il y a eu le 17 novembre devant l’Assemblée et nous y étions. Il y a eu le 21 novembre au Trocadéro et nous y étions. Il y a eu le 28 novembre un peu partout en France, et nous y étions, entre République et Bastille. La première fois, avec le sentiment d’être des animaux en cage, parqués derrière des grilles et des gendarmes qui, eux, filmaient. La deuxième, avec l’impression d’être des clowns, condamnés à faire des tours de piste autour de la statue du maréchal Foch. La troisième, libres au moins de marcher – non par la volonté du préfet de police, mais par la pugnacité des militants qui avaient fait lever son arrêté d’interdiction. Et pour se déplacer jusqu’au point de rassemblement, il avait encore fallu remplir les modèles d’attestation heureusement mis en ligne par les collectifs de défense des droits humains. Mais il est vrai qu’on ne compte plus trop sur le gouvernement pour garantir effectivement la liberté de manifester. Entre la deuxième et la troisième date il y avait eu l’éviction brutale des migrants sous l’allégorie de la République et le passage à tabac de Michel Zecler, homme noir, par quatre « gardiens de la paix » aux « bons états de service ». Cette fois les condamnations verbales venaient de ceux-là même qui en portaient la responsabilité politique… mais alors il était trop tard : elles ne suffisaient plus. Un an plus tôt, Macron s’était déjà dit « bouleversé » par la brutalité documentée des Misérables. Depuis, rien n’avait changé. Qu’importait alors qu’il se dise désormais « choqué » par cette nouvelle incartade de sa police ?
Le 28 novembre, donc, la place de la République, envahie par une marée humaine, se rendait digne de son nom. On la voyait ondoyer, cette marée, juché sur l’escalier du boulevard du Temple comme sur la vigie d’un bateau, au rythme des oscillations des cinquante mille individus au moins qui la composaient. « C’est beau une foule qui devient peuple », avais-je écrit à propos des manifestations contre la retraite à points, il y a un an déjà. Le 28 novembre, à nouveau, j’ai vu se former le peuple qui vient périodiquement rappeler ses droits aux dirigeants trop oublieux. Rappeler que selon l’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, la « force publique » est « instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée » ; rappeler l’égalité de tous les citoyens entre eux et face à l’État, quelle que soit leur couleur de peau, leur classe, leur opinion.
Bien au-delà du collectif ad hoc qui la combat efficacement, la loi Sécurité globale agrège contre elle toutes les fractions du peuple qui subissent depuis plus ou moins longtemps la violence illégitime de l’État : jeunes des quartiers populaires, gilets jaunes, journalistes, et la masse immense, anonyme, des habitués des récents mouvements sociaux. Eux savent que face à la répression, ciblée ou aveugle, les images sont leur seule égide. Ils savent que pour un passage à tabac dans un sas vidéosurveillé, pour un manifestant matraqué sous l’objectif d’un téléphone portable, pour un migrant molesté devant une caméra, bien d’autres violences et brimades passent sous les radars de l’opinion publique. Ils savent que s’il y a eu, par le passé, des politiques, des fonctionnaires évidemment soucieux de créer entre la population et sa police un lien de confiance, non sans succès, il n’y a, en revanche, jamais eu d’âge d’or. La technologie a simplement fait pénétrer dans notre champ de vision une brutalité qui en était absente jusque là. Elle a permis d’ouvrir une nouvelle page de l’histoire des gouvernés.
« Les sorties de la manifestation se trouvent rue de la Roquette, boulevard de la Bastille et rue de Lyon », serinait une voix de policière, lorsque le cortège, empêché d’avancer par des échauffourées, n’avait pas encore fini d’atteindre la place de la Bastille. Oui, mais voilà : à mesure qu’elle touchait son but, en ce 28 novembre, la manifestation ne voulait plus partir. Elle s’émerveillait plutôt des couleurs du ciel où stationnait un drone de la préfecture de police et où s’élevait, étonnant spectacle, un interminable panache de fumée, noir à la base, rose au sommet. En même temps, les prises de parole s’organisaient : officielles et officieuses. Ici on réclamait justice pour la victime d’une « bavure » policière ; là on entonnait un Chant des Partisans sous la baguette de Camélia Jordana.
Je ne crois pas que la France ait une âme, comme on l’entend beaucoup en ce moment, mais je crois qu’elle a un peuple, et je crois que ce peuple était là, le 28 novembre, autour de la colonne où sont inscrits les noms des martyrs de Juillet. Martyrs pour rien, puisqu’après Charles X devaient venir Louis-Philippe, Napoléon III, Thiers, enfin ? Certainement pas pour rien : pour signaler que l’histoire est constamment faite par le bas et constamment récupérée par le haut. Ainsi un roi décida de couler dans le bronze la mémoire des citoyens qui, par leur révolte, avaient permis son avènement. Ainsi Sarkozy citait Jaurès et Guy Môquet. Ainsi Macron a-t-il appelé son livre-programme de 2017: Révolution.
L’ironie ne s’arrête pas là, et elle est mordante. On se rappelle bien sûr la genèse de la loi Sécurité globale. Au commencement, le gouvernement avait fait passer à Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du Raid transformé en député par l’opération du Saint-Macron, le texte d’une soi-disant « proposition » de loi destinée à être votée lors d’une niche du groupe majoritaire. Sans doute Fauvergue y a mis sa patte : n’ôtons pas aux députés le peu qui leur reste. Darmanin, dont la mission au gouvernement est de récupérer la police qui lui file comme le sable entre les doigts, y a mis en tout cas son grain de sel : l’article 24, introduit par amendement. Tollé ! Après être restée silencieuse, la grande presse a compris qu’on lui en voulait aussi, s’est emparée du sujet, et la mobilisation est allée croissant.
Deux semaines durant, l’Élysée a fermé les écoutilles, envoyé le gouvernement faire un assez médiocre service après-vente : des ajustements qui ne changaient rien au fond. Et puis, l’affaire des migrants évacués place de la République, l’affaire Zecler ont changé la donne. Avant même la manifestation du 28, le gouvernement avait baissé d’un ton. Le jeudi 26, Castex se piquait de droits de l’Homme, saisissait la Commission nationale consultative en la personne de Jean-Marie Burguburu, à qui il donnait mission de réécrire l’article le plus litigieux. Le 27, les présidents des assemblées furieux rappellaient au premier ministre que pour être législateur de facto, il n’est pas pour autant législateur de jure. Castex alors se rebiffait : il n’était pas question de réécrire l’article, mais de faire des propositions de réécriture. Le 30, enfin, au moment où Darmanin, en service commandé, faisait un demi acte de contrition devant la commission des lois de l’Assemblée, les présidents des groupes majoritaires se rappelaient que les députés existaient et pouvaient éventuellement jouer un rôle dans la vie de la nation. Ils parlaient d’« inquiétudes à dissiper » ; promettaient de reprendre l’article depuis le début. Un peu tard, peut-être, après s’être complaisamment fait marcher dessus par le gouvernement, après n’avoir rien trouvé à redire à ce nouveau train de mesures antidémocratiques. Un peu court, également. À moins qu’il ne s’agisse d’une nouvelle astuce de Macron, trop content de pouvoir refiler la patate chaude sans paraître se dédire ?
Politiquement, à qui profite le crime ? Pas aux LR, c’est certain. Pour pouvoir en tirer parti à la présidentielle, encore faudrait-il qu’ils aient une chance d’atteindre le second tour. Peut-être au RN, en revanche. Déjà Le Pen et ses lieutenants dénoncent les faux-semblants de Macron, incapable de pousser jusqu’au bout la logique de l’ordre. Les institutions de la 5e finiront-elles par avoir la peau de celui qui prétendait leur restituer leur verticalité jupitérienne ? L’histoire, ici non plus, ne manque pas d’humour.
Derrière le problème policier, derrière le vaudeville politique, la crise démocratique affleure toujours. On a vu le peuple dans la rue, réclamer contre l’article 24, mais on ne l’a pas vu à l’Assemblée où il est censé être représenté. On a vu des institutions dénoncer la dérive sécuritaire – la Défenseure des droits, le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU –, mais on n’a pas vu quiconque, au sommet de l’État, émettre le moindre doute sur cette aventure législative pour le moins hasardeuse. Il se dit à présent que le gouvernement recule, qu’il pourrait remettre sur le métier certaines malfaçons de l’institution policière saccagée par les années Sarkozy : la formation, l’encadrement… Y aura-t-il aussi des instructions pour que les policiers cessent de confisquer ou détruire les téléphones qui les filment d’un peu trop près ? Il n’est pas interdit de rêver.
Le malaise cependant est beaucoup plus large. Il appelle une réponse constituante, en ce sens que les institutions actuelles – organisation des pouvoirs dans la République, fonctionnement d’organes comme l’IGPN, etc. – ne permettent pas, ou plus, de garantir les droits qui sont la base du contrat social. Cette question dépasse de loin les « brebis galeuses » égarées parmi les « gardiens de la paix », dépasse de loin Lallement et Darmanin, dépasse de loin même la police en général, et d’aussi loin tous les noms d’oiseaux qui leur sont indifféremment adressés. Il n’est pas une  politique ponctuelle, si vertueuse soit-elle, ni même une réforme d’ensemble, qui y mettra un terme, si l’on ne rediscute pas dans un même mouvement les règles de notre société politique: comment on casse la verticalité du pouvoir pour lui substituer une association plus intime et constante de la population, comment les gouvernants et les fonctionnaires rendent des comptes sur leur action, etc. À ce propos justement, le 28 novembre, j’avais avec moi une pancarte qui disait, au recto : « Qui veut une police pour le peuple exige un gouvernement par le peuple » ; au verso : « 6e République, maintenant ».
politique ponctuelle, si vertueuse soit-elle, ni même une réforme d’ensemble, qui y mettra un terme, si l’on ne rediscute pas dans un même mouvement les règles de notre société politique: comment on casse la verticalité du pouvoir pour lui substituer une association plus intime et constante de la population, comment les gouvernants et les fonctionnaires rendent des comptes sur leur action, etc. À ce propos justement, le 28 novembre, j’avais avec moi une pancarte qui disait, au recto : « Qui veut une police pour le peuple exige un gouvernement par le peuple » ; au verso : « 6e République, maintenant ».
N’est-ce pas là le mot d’ordre qui les rassemble tous ?