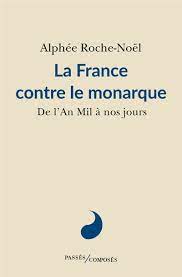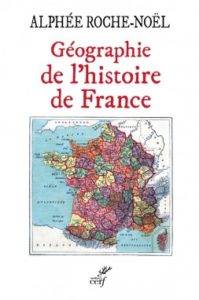Odilon Redon, L’œuf, BNF.
Quand il demande, dans un texte récent, «où est passée ta liberté ? », on peut dire que Rapeloche n’y va pas avec le dos de la cuiller. Mais il a raison de dénoncer le régime carcéral auquel nous nous sommes soumis de notre propre mouvement, non par nécessité mais par passivité, non par devoir civique, mais par manque de vigilance citoyenne. Ce régime carcéral est d’ailleurs bien plus large et insidieux que notre condition présente d’enfermement : nous verrons pourquoi.
Pour commencer par ce premier sujet, précisons d’emblée que nous ne sommes pas opposé par principe au confinement – mesure douloureuse, mesure inhumaine, mais qui peut être justifiée, à titre exceptionnel, à condition qu’elle soit discutée, préparée, assumée comme une décision commune ; à condition qu’elle ne soit pas prise comme elle le fut en mars et vient surtout de l’être en octobre : dans la précipitation, dans l’improvisation… dans le secret d’un bureau, par un homme seul.
La situation où nous sommes aujourd’hui ne résulte ni de l’imprévisible, ni de l’inéluctable, mais bien d’une série d’options qui forment ensemble une politique déterminée. Ainsi Macron a décidé souverainement d’engager le premier déconfinement, mis en œuvre dans le plus grand désordre par celui qui allait remplacer Philippe au poste de grand vizir. Ainsi Macron et son nouveau gouvernement ont affirmé que « la vie {devait} continuer avec le virus ». Ainsi les mêmes se sont exposés à toutes les complications désormais bien connues de l’automne, se sont lié les mains, se sont contraints eux-mêmes aux injonctions paradoxales, aux revirements de dernière minute, aux règles kafkaïennes, jusqu’à cet absurde nouveau confinement «assoupli » qui, en renvoyant les perspectives d’amélioration aux calendes grecques, condamne ses initiateurs au durcissement et à la prolongation, sine die. Ainsi ont-ils choisi leurs mots, leur lexique martial ; ainsi ont-ils prétendu faire la leçon à une population nettement moins insouciante qu’ils ne se sont montrés irresponsables.
Entre mars et octobre, pourtant, ils avaient eu tout le temps de voir venir. L’été commençait à peine que déjà le conseil scientifique alertait sur la forte probabilité d’une violente seconde vague. Nous-même, qui ne sommes pas grand clerc, écrivions dans un papier publié le 7 mai, sur la foi de notre seule lecture de la presse: « à mesure qu’il approche, le déconfinement ressemble de moins en moins à une délivrance et de plus en plus à un saut dans le vide. Les épidémiologistes nous préviennent, qui voient déjà venir la deuxième vague, et ne peuvent seulement dire si elle sera haute comme un ou deux immeubles. ». Erreur en mars ; faute en octobre.
Qu’on n’entende plus en tout cas les petits télégraphistes nous rabâcher que «le gouvernement a préféré protéger la santé plutôt que l’économie », car en vérité le Medef a obtenu satisfaction sur tous les points ou presque (droit du travail, chômage partiel, impôts de production), et le télétravail reste très peu suivi, quoi qu’en dise le ministre de la santé.
Nous y revoilà donc comme au printemps : derrière les murs que nous avons nous-même érigés. Mais quand le premier confinement était l’anormal, le second est la norme. On s’habituerait presque à voir nos libertés couler comme le sable entre nos doigts, à force de décrets, d’arrêtés, de lois adoptés en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, inspirés dans des conseils de défense où le regard citoyen n’a pas sa place, dont il n’est tenu aucun compte rendu, ou dans des conseils scientifiques dont la légitimité tient au seul fait du prince. Par extraordinaire, les députés des oppositions, émancipés pour la seconde fois sous le présent quinquennat, sont parvenus à faire adopter un amendement pour fixer la fin de l’état d’urgence en décembre, au lieu de février. Ils ont eu raison car les mesures restrictives des libertés ne doivent, à aucun prix, échapper au contrôle du peuple et de ses représentants. Et Véran a eu tort de s’en agacer : c’est l’honneur et le devoir des élus de la République que de veiller sur les libertés de leurs concitoyens.
Après une suspension en trompe-l’œil, qui avait surtout été l’occasion de faire passer dans le droit commun des mesures exorbitantes, le covid-19 avait ressuscité l’état d’urgence activé en 2015 dans la foulée des attentats islamistes. Et voilà que ces mêmes attentats nous reviennent comme un boomerang, en plein dans la nuque. Singulier rappel d’une histoire que nous avons à tort crue derrière nous, mais qui n’était qu’un signe avant-coureur. Nous voici donc enfermés chez nous, sommés, pour sortir masqués, d’attester sur l’honneur, et croisant tous les 500 mètres des marsouins armés en guerre. Il s’en trouvera toujours pour considérer qu’ainsi circonvenus nous sommes bien plus en sécurité, garantis contre les virus et autres terroristes. Je suggère que ceux-ci se claquemurent avec lampe de poche et rations de survie dans leur placard à balais : il ne leur arrivera plus jamais rien.
Assez blagué : cette ambiance carcérale, cette ambiance martiale n’a rien de particulièrement drôle et nous pressentons tous qu’elle inaugure une époque étouffante, où l’espace laissé à chacun pour vivre, se mouvoir, penser, s’exprimer sera réduit à peau de chagrin. Les attentats sont une inextinguible source d’angoisse et justifient en retour la militarisation de la vie civile. Utilisée contre le peuple lors des derniers grands mouvements sociaux, lorsque la Révolution en avait fait la garante de ses droits, la force « publique » sera bientôt placée de facto hors du contrôle citoyen par la loi dite Sécurité globale, qui punira d’un an de prison et 45 000 euros d’amende le fait de diffuser des images de policiers. Ainsi disparaîtra l’outil qui avait permis de mettre au jour la violence d’État, si longtemps cachée, si longtemps niée, contre les habitants des banlieues et désormais de la « France périphérique ». Les nouvelles technologies auraient pu être mises au service des personnes, mais elles seront seulement utilisées pour les fliquer et les brimer. Quant aux policiers, j’affirme qu’on ne les défend pas en les dressant contre la population, mais au contraire en les en rapprochant, en les restaurant dans leur mission originelle, définie par l’article XII de la Déclaration de 1789.
D’où nous parlons nous sommes à l’exact opposé de ce qui pourrait être une politique d’apaisement et de concorde : sous le règne des boutefeux et des bateleurs. La peur est le combustible de ces gens, ministres ou aspirants, éditorialistes stipendiés, grandes gueules en tout genre qui se sont fait une spécialité de débusquer, partout, des traîtres à la République.
La vérité est que la République a justement failli le jour où le soupçon est devenu l’artefact rhétorique de ceux qui, de ses palais à ses organes de presse, la dirigent et l’animent. Ainsi du soupçon contre les musulmans, victimes d’un racisme culturel vieux de deux siècles, toujours latent, ressuscité avec une virulence inédite à la faveur de la poussée islamiste et des bouleversements récents du monde. Ainsi aussi du soupçon plus récent, mais tout aussi significatif, contre ceux qui cherchent des explications dans l’apparence du chaos. « Expliquer, c’est excuser », nous a-t-on dit. Mais comment réparer, comment combattre si l’on n’explique pas ? Foin de tout cela. On a rassemblé tout ce petit monde dans un même sac, sur lequel on a écrit ce slogan infamant: « islamo-gauchiste». La nouveauté est que ce taxon baroque, qui ne renvoie à rien, ne désigne rien, ne signifie rien, a reçu l’imprimatur du gouvernement. Blanquer l’a utilisé expressis verbis avec des airs de vouloir purger l’université (ce que ne manque pas de faire sa collègue Vidal en restreignant la liberté d’expression des professeurs et autres maîtres de conférences). Castex, sur TF1, ne l’a pas démenti, rejetant au passage tout « regret » sur la colonisation. (Était-ce le débat ?) Invité récemment de France Culture, le professeur Jean Chambaz a dézingué d’un mot l’imposture, en rappelant le fantasme « judéo-bolchévique » des pires années du XXe siècle. Pour ma part, s’il s’agit d’être accablé de noms d’oiseaux, je préfère encore me choisir celui de socialo-papalin que Clemenceau adressa à Jaurès, cet immense socialiste, cet immense humaniste, cet immense républicain indûment suspecté de complaisance à l’égard de l’Église, parce qu’il mesurait, lui, toute les nuances de l’âme humaine. De Jaurès, encore, Nicolas Cadène, rapporteur général de l’Observatoire de la laïcité jeté pêle-mêle parmi les suspects d’islamo-gauchisme, rappelle l’admirable formule : « La République doit être laïque et sociale. Elle restera laïque si elle sait rester sociale. »* Après une si juste observation, reste-t-il quelque chose à dire ? Plus trivialement peut-être, j’ai écrit dans un billet récent pourquoi la politique du soupçon est une stratégie dangereuse et vouée à l’échec… selon bien sûr les buts qu’on s’est donnés. Et pourquoi le mot de « séparatisme » est hautement inflammable.
Voilà pour l’atmosphère malsaine du dehors, qui pénètre dans nos intérieurs chaque fois que nous ouvrons les fenêtres pour aérer. Sera-t-elle plus respirable demain, lorsque le monde entier donne des signes précurseurs d’embrasement, du Ladakh à la mer Égée, en passant par le Haut-Karabagh ? Lorsque les catastrophes climatiques s’accumulent y compris sous nos latitudes théoriquement plus clémentes ? Parmi nos observateurs avisés, je crains qu’il ne s’en trouve beaucoup pour espérer que l’élection de Biden – s’il se sort du piège tendu par Trump – restaurera l’ordre du monde, selon une bonne vieille mythologie hollywoodienne («bring balance to the Force »). Ceux qui ont fait de Trump un monstre, alors qu’il n’était qu’un clown, en seront pour leurs frais. Car le bidenisme pourrait bien être un autre signe des temps : queue de comète d’une élite démocrate décatie, qui n’a su ni quitter la scène, ni révoquer l’antique démon américain : le capitalisme prédateur.
* L’Humanité, 5 novembre 2020.