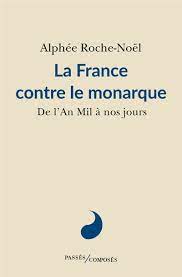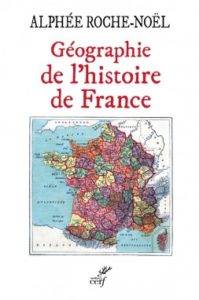Louis-Joseph-Amédée Daudenarde (1839-1907) et Auguste Deroy (1825-1906). « Une séance de la Commune dans la salle des Maires à l’Hôtel de Ville, 1871 ». Estampe. Paris, musée Carnavalet.
Il y a deux mois, je me réjouissais que les habitants de Delhi fussent sur le point d’atteindre à l’immunité collective. La presse alors s’était fait l’écho d’une étude mettant en évidence que, peut-être, la promiscuité, la pauvreté, en favorisant la propagation virale plus que nulle part ailleurs, avaient permis à la population de se faire ses anticorps. Las !, Delhi semble depuis lors être devenu l’épicentre du cataclysme. Ce qui avait hier l’apparence du vraisemblable n’était-il qu’une illusion ? Ou les variants du printemps ont-ils seulement pulvérisé les espérances, fondées, de la fin de l’hiver ? Qu’importe, la terrible réalité est là ; la sorte de morale de l’inégalité que j’avais naïvement formulée (« il faut qu’il y ait une justice ») a aussitôt sombré dans les eaux de la Yamuna, cet affluent du Gange qui irrigue le territoire-capitale. Il n’y a du reste pas que des pauvres à Delhi, et il y en a même relativement moins que dans bien des régions de l’Inde. Là-bas comme chez nous, cependant, ce sont eux, les parias, les plus implacablement frappés. Aux sceptiques, la pandémie a montré par a+b que le modèle de développement dont nous redoutons collectivement l’anéantissement a minutieusement hiérarchisé les vies humaines, de la plus respectable à la plus méprisable. Or, si les gouvernements du monde (entendez, des pays riches) ont rouvert les vannes de la dette, afin que la machine capitaliste puisse redémarrer à pleine puissance une fois passées les ultimes répliques du coup de grisou, on ne voit pas qu’ils aient tenté un seul instant de briser cette scandaleuse échelle des valeurs.
Aujourd’hui, cependant, tout nous alerte contre ces fractures, ces exclusions, les malheurs qu’elles engendrent et les principes qu’elles bafouent. Tout nous indique qu’il est temps non plus seulement d’en corriger les effets, mais d’en anéantir les causes. À défaut, à observer les déséquilibres persistants, les injustices flagrantes, la misère si étendue, la richesse si concentrée, la décomposition sans fin des classes moyennes, la consolidation indécente des positions des puissants, on se prend à prophétiser, comme l’abbé Brossette dans Les Paysans* : « Le festin de Balthasar sera donc le symbole des derniers jours d’une caste, d’une oligarchie, d’une domination !… (…) Mon Dieu ! si votre volonté sainte est de déchaîner les pauvres comme un torrent pour transformer les sociétés, je comprends que vous aveugliez les riches. »
À moi, donc, les leçons naïves ; à Balzac, défenseur paradoxal du trône et de l’autel, l’eschatologie de l’inégalité, l’étude de mœurs en forme de réquisitoire contre les iniquités.
Il semble que le choc social à venir doive ébranler y compris (surtout ?) les régimes dont nous avions fétichisé la stabilité. Ainsi, nos démocraties, si parfaites que nous ne voulions rien en changer, n’en finissent plus de convulsionner. Au lieu de rythmer normalement leur existence, les grandes échéances électorales, traduisant (mal) les inquiétudes et déceptions des populations laissées pour compte, provoquent immanquablement la tétanie des classes politiques qui les chapeautent. Partout, le meilleur s’éloigne comme perspective possible ; partout, le pire est l’horizon et l’expédient.
Voyez plutôt la situation des Hauts-de-France, où tant se jouera aux régionales de juin. Le Monde en a récemment publié des cartes, qui combinent données économiques et résultats des derniers scrutins**. Dans ces départements de contrastes, mais couturés de cicatrices, les linéaments du déclassement épousent ceux du vote frontiste. En 2015, la liste Le Pen avait réuni plus de 40 % des suffrages ; quinze points derrière à l’issue du premier tour, Bertrand l’avait emporté au second grâce à un « front républicain » en forme de baroud d’honneur. Six ans plus tard, on ne voit pas bien comment le nouveau héros autoproclamé de la République en péril pourrait rééditer cette victoire par abandon et faire échec à des logiques qui dépassent largement sa petite personne. Se peut-il par contre que les forces de progrès, alliées pour les besoins de la cause, parviennent à enrayer la mécanique infernale ? Je l’espère, mais n’ose y croire.
La présidentielle en effet agit comme un aimant puissant, comme un astre satellisant tout objet qui passe à proximité. Pour notre malheur, depuis 1958-65, notre république est affublée de ce kyste monstrueux, germé en pleine guerre d’Algérie d’une peur savamment exploitée, et qui laisse aujourd’hui aux électeurs le choix entre deux options : l’une exécrée, l’autre, ô combien plus exécrable. C’est peu dire qu’en France les soubresauts de notre époque tourbillonnante auront une ampleur, une résonance particulières. Dans un billet vieux de deux ans, j’ai dit pourquoi la victoire sur le fil de Le Pen était vraisemblable, et cette probabilité me semble encore plus forte désormais. À gauche, alors, beaucoup voyaient dans cette hypothèse une hérésie arithmétique en plus d’un argument concédé à Macron. Depuis que les sondages, cette Pythie moderne, crient l’imminence de la catastrophe, on n’a plus que ce mot à la bouche, et Libé sort des unes dignes d’avril 2002. Mais je ne sais s’il faut y voir une véritable prise de conscience, ou une sorte de prophétie autoréalisatrice – une marque d’espérance ou de fatalité.
Pour elles-mêmes, ces conjectures n’ont qu’un intérêt limité, si ce n’est celui de nous préparer au pire (mais y est-on jamais préparé ?). Plus fondamentalement, elles ont le mérite d’éclairer les biais, les malfaçons de notre société politique.
Parmi ces défauts de structure, il y a, je l’ai dit, le mantra du « charisme » et du « chef véritable », la passion redoutable de l’incarnation, le triste vestige de la monarchie que nous croyions avoir congédiés en 1792-93, puis en 1870-71, enfin en 1875-79, et qui nous sont revenus en pleine poire un certain mois de mai 1958, sous la forme d’un général mégalomane. L’architecture hypercentralisée de la 5e République, la concentration des pouvoirs exécutif et législatif entre les mains d’un seul individu vont avec, et sont pareillement symptomatiques de cette maladie juvénile de la démocratie française qu’est l’élection d’un président fort au suffrage universel direct.
Il y a aussi, et cette fois le fait est partagé par tous les régimes démocratiques, ce constat imparable que l’ensemble des procédures et modalités d’élaboration des choix communs tendent globalement, sous couvert d’égalité civique, à maintenir les grands équilibres – ou déséquilibres ? – de la société, au bénéfice des classes dominantes et au détriment des classes moyennes et subalternes. Ce constat, au total, a souffert assez peu d’exceptions depuis que la République est en place, et toutes dans l’épaisseur du trait – mais il est vrai que nous revenions de loin.
« La France est de droite », m’a récemment dit un ami, quelque peu désabusé. « La France n’est de droite que parce que les pauvres ne votent pas », ai-je répondu, non moins désolé. Ma repartie, caricaturale, aurait certes appelé mille nuances, mais l’idée était là : si ceux qui ont le plus intérêt au changement étaient réellement intégrés à la citoyenneté, alors, sans doute, l’orientation générale de la politique refléterait plus fidèlement les aspirations du corps social. Peut-être même – qui sait ? – la société en sortirait-elle plus juste, moins inégalitaire – et ceci vaut tant pour la France que pour le monde. Tout infatués que nous sommes du « suffrage universel », nous voyons rarement que, dans les mentalités, ce droit tout théorique a conservé la charge fonctionnelle de l’époque du cens et du marc d’argent. Interrogez autour de vous, et vous verrez, au doigt mouillé, combien sont nombreux les beaux esprits convaincus que pour avoir le droit de glisser son bulletin dans l’urne, il faudrait être imposable sur le revenu et avoir passé un test de QI. Pendant ce temps-là, bien des électeurs en titre s’abstiennent parce qu’ils ne voient pas bien ce qu’un scrutin pourrait changer à leur rude existence, et bien d’autres qui partagent notre sol et se tuent à la peine ne se sont toujours pas vus reconnaître, malgré les promesses réitérées (depuis 1972…), le simple droit de participer aux scrutins locaux. Bonne fille, la République, soi-disant fraternelle et universaliste, ne semble pas voir d’un si mauvais œil cette constriction naturelle qui concentre le pouvoir entre des mains expertes. Jusqu’à ce que…
Rempart fragile de toutes les dominations, de toutes les rentes de situation, le rétrécissement, l’exclusivité du droit de Cité, la consanguinité des gouvernants sont des fissures profondes aux fondations des sociétés humaines. Puisqu’il n’y a guère de point d’aboutissement logique et inéluctable à un raisonnement où l’on a jeté, pêle-mêle, Delhi et les Hauts-de-France, Balzac et De Gaulle, j’irai chercher ma conclusion dans la Commune, décidément source d’inspiration pour notre temps. Dans un billet de janvier (que, soit dit en passant, le recul et les informations collectées depuis lors me feraient nuancer), je citais les termes de l’affiche du Comité central de la Garde nationale, en préparation des élections du 26 mars 1871 (« Citoyens, Ne perdez pas de vue que les hommes qui vous serviront le mieux, etc. »). Ce scrutin envoya au Conseil général de la Commune une moitié d’ouvriers et d’artisans et mit ainsi en place la première et l’unique assemblée authentiquement populaire que notre pays ait connu à un niveau (quasi) national. Pour le meilleur, avant que Versailles n’y mette son grain de sel. Au total, l’exemple de l’éphémère « constitution communale » nous pose la question de savoir s’il peut y avoir une politique juste, durable, profitable à toutes et tous, qui n’émane pas de l’ensemble des classes et groupes dont est composée la société.
La réponse, me semble-t-il, ne souffre pas d’hésitation.
* Balzac, Les Paysans, Paris, Gallimard, 1975 [1855].
** Édition 20 avril 2021.