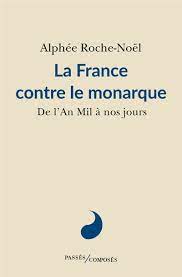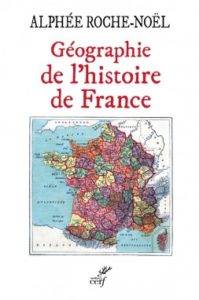Cette semaine, la mort de George Floyd a connu ses premières répercussions politiques de notre côté de l’Atlantique. Ceci grâce à la mobilisation du collectif Vérité pour Adama et des nombreux citoyens venus, à son appel, manifester devant le tribunal de Paris (admirable Assa Traoré, qui a refusé l’invitation à « prendre le thé » de la garde des sceaux, en rappelant l’exigence démocratique de séparation des pouvoirs !) ; grâce aussi au travail de plusieurs organes de presse (Arte Radio, StreetPress, etc.), nourri par les témoignages courageux d’agents de la force publique qui ont fait passer leur devoir républicain avant tout esprit corporatiste ou de conservation personnelle.
Cette semaine, la mort de George Floyd a connu ses premières répercussions politiques de notre côté de l’Atlantique. Ceci grâce à la mobilisation du collectif Vérité pour Adama et des nombreux citoyens venus, à son appel, manifester devant le tribunal de Paris (admirable Assa Traoré, qui a refusé l’invitation à « prendre le thé » de la garde des sceaux, en rappelant l’exigence démocratique de séparation des pouvoirs !) ; grâce aussi au travail de plusieurs organes de presse (Arte Radio, StreetPress, etc.), nourri par les témoignages courageux d’agents de la force publique qui ont fait passer leur devoir républicain avant tout esprit corporatiste ou de conservation personnelle.
N’en jetez plus, la coupe est pleine : dimanche, Macron exige de son ministre de l’intérieur qu’il « accélère sur la déontologie policière ». Il est vrai que les propositions demandées en janvier pour « améliorer » cette déontologie avançaient à pas comptés, et, comme souvent sous ce régime où le secret est une vertu et la hiérarchie un dogme, à l’abri du regard public. Pas plus tard que le lendemain, M. Castaner, qui, depuis sa nomination place Beauvau, à la veille de la révolte des gilets jaunes, s’était constamment dit « derrière » les forces de l’ordre, lorsqu’il aurait au contraire dû être « devant », tient une conférence de presse. Il y annonce la fin de la technique de l’étranglement (que la mort de Cédric Chouviat n’avait pas suffi à faire cesser…) et la suspension systématique des auteurs de propos racistes, faisant réagir aussi sec des syndicats qui ne perçoivent pas, semble-t-il, la coïncidence entre l’intérêt de la profession et celui de la population tout entière.
Faut-il se réjouir de cette « prise de conscience » ? Oui, mais avec modération.
Premièrement parce que la technique de l’étranglement sera remplacée par l’usage du Taser, nouvelle qui ne satisfera personne à part la société états-unienne Axon, qui a fait sa fortune de la fabrication de ces vraies-fausses « armes non létales ».
Deuxièmement, parce que Macron, as de la prestidigitation, pourrait avoir trouvé ainsi un expédient pour éviter la critique de sa propre politique de « maintien de l’ordre », dont il était question dans mon précédent billet. Depuis plusieurs jours, en effet, c’est sur le « racisme dans la police » que se concentrent la communication du gouvernement et, de plus en plus, le débat public, qui plaque volontiers et sans nuance la protestation Black Lives Matter sur la situation française. Avec le risque de faire de l’identité un point focal, sans véritable changement dans les faits. (Voyons au passage comme la « sociétalisation » du racisme dans les années 1980 a fait avancer la cause de la « Marche des beurs » : près de quarante ans plus tard, nous en sommes – quasiment – toujours au même point…) « Ré-encastrer » la lutte contre le racisme dans la lutte démocratique et sociale au sens large est donc une urgence absolue.
De fait, si le racisme est une composante essentielle du problème de l’usage de la « violence légitime » – aux États-Unis, où l’héritage de l’esclavage structure toujours la société politique*, comme en France, où le passé colonial conditionne encore maints réflexes au sein de l’État – il ne le résume pas à lui seul. La brutalité de la réponse policière lors des manifestations de gilets jaunes et contre la retraite à points n’a évidemment rien à voir avec du racisme (la majorité des manifestants n’appartenaient pas à des « minorités visibles » et beaucoup ont perdu un œil ou une main dans l’affaire), mais avec une pratique autoritaire du pouvoir, contraire en tout cas à l’article 12 de la Déclaration de 1789 qui proclame que la force publique est « instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ». Or, sur ce chapitre, nous n’avons entendu encore aucun mea culpa de l’exécutif – plutôt des satisfecits – ni aucune remise en cause de la doctrine d’emploi. La retrait de la grenade GLI-F4 est la maigre concession d’un pouvoir qui ne veut rien céder sur la méthode.
C’est pourtant bien cette question, au cœur d’un pacte démocratique douloureusement malmené ces derniers temps, qui doit nous occuper, aussi vrai que toutes les citoyennes et tous les citoyens ont le droit de voir leur sûreté et leurs libertés effectivement garanties : habitants des banlieues descendants de l’immigration africaine qui subissent, depuis des lustres, humiliations et violences, dans le coupable silence de la société médiatique et politique, manifestants empêchés de porter leurs revendications et simples usagers du service public de la police.
Ces combats ne s’excluent pas : ils se rejoignent. Dévoiler le lien entre l’économie de la relégation sociale, l’usage antidémocratique de la force et les schémas idéologiques racistes : voilà le moyen de faire cause commune sur des mots d’ordre porteurs d’espoir pour l’avenir, en évitant le piège de la diversion et le risque de la parcellisation. N’est-ce pas ainsi que l’on refait peuple ?
Il est amusant au passage de constater que ce type de crise conduit en général le cuistre à tomber le masque. Ainsi M. Bardella, porte-parole bien peigné du RN, qui accuse le gouvernement de « lâcher » la police, dans une grossière opération de dragage électoral. Ce genre d’échantillon donne une bonne idée de la manière dont ceux qui ont fait de la xénophobie leur mantra utiliseraient la force « publique » pour réprimer l’expression populaire, si, par malheur, ils accédaient au pouvoir. Les citoyens dans toutes leurs composantes auraient à en souffrir ; le racisme deviendrait la manifestation la plus abjecte d’un pouvoir fondé sur la peur ; la politique menée prétendument au nom du peuple ne servirait que les intérêts des puissants.
Il est hélas probable que nous n’ayons encore rien vu.
* Il faut regarder à cet égard l’excellent film-documentaire de Raoul Peck, sur les mots de James Baldwin : I am not your negro (diffusé sur Arte).