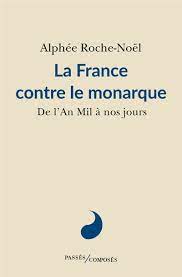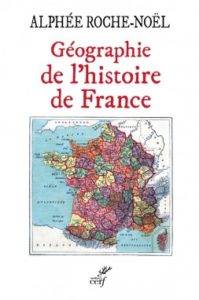Depuis que Macron a osé le mot de «séparatisme», je tourne autour de cet objet inflammable en craignant de m’y brûler les doigts. Fallait-il s’en tenir à bonne distance ? Tenter au contraire de dévoiler la supercherie ? Je ne savais plus. Et puis, j’ai lu les deux tribunes de Mélenchon sur la «créolisation »*. La pertinence de son propos, sa résonance avec mes réflexions du moment m’ont décidé à livrer ici quelques pensées non-exhaustives.
Depuis que Macron a osé le mot de «séparatisme», je tourne autour de cet objet inflammable en craignant de m’y brûler les doigts. Fallait-il s’en tenir à bonne distance ? Tenter au contraire de dévoiler la supercherie ? Je ne savais plus. Et puis, j’ai lu les deux tribunes de Mélenchon sur la «créolisation »*. La pertinence de son propos, sa résonance avec mes réflexions du moment m’ont décidé à livrer ici quelques pensées non-exhaustives.
Dans un livre paru il y a bientôt deux ans, Géographie de l’histoire de France, me rappelant les manifestations de l’entre-deux tours de 2002 auxquelles j’avais participé, j’avais écrit que le slogan «nous sommes tous des enfants d’immigrés » était une actualisation de l’incipit de Lavisse «nos ancêtres les Gaulois ». Comment décrire autrement une France littéralement régénérée par son immigration, dont l’histoire échappe à toute volonté d’ethnicisation ? Le mot d’Édouard Glissant remis au goût du jour par Mélenchon renferme, me semble-t-il, un peu de cette idée.
Le fait est que le fantasme de la « race », de l’« ethnie », n’est pas opérant pour rendre compte du processus de construction de la société française. On se rappelle l’heureuse formule de Renan sur la « grande chaudière » dans laquelle ont «fermenté les éléments les plus divers ». Renan parlait de la France du Moyen Âge, dont les chroniqueurs avaient cherché les origines non seulement chez les Francs, non seulement chez les Gaulois, non seulement chez les Romains, mais à Troie, dans la maison de Priam. C’est dire si, déjà, le monde entier y existait.
Ce qui est vrai de la France ancienne l’est encore plus de la France nouvelle, celle d’après la Révolution, qui vit affluer, au XIXe siècle, les immigrants européens : Belges, Polonais, Italiens, puis, au XXe, ceux d’Afrique et d’Asie, de l’ex-empire colonial : Algériens, Marocains, Sénégalais, Vietnamiens, etc. Encore cela est-il trop court, trop partiel, trop grossier pour rendre compte de l’extraordinaire mélange de populations et d’habitus qui s’est produit sur le territoire situé entre « la mer océane, le Rhin, les Alpes, les Pyrénées », comme le définissaient déjà les géographes de l’Antiquité.
Ce bel exemple d’une humanité se faisant plus proche d’elle-même – par la force des choses, non sans heurts, non sans malheurs – ne nous a pas permis d’échapper à la tentation xénophobe ou raciste. Collectivement nous portons le poids de l’esclavage, de la colonisation, du gouvernement antisémite de Vichy, pour ses aspects les plus systémiques, qui ne furent jamais ni sans causes, ni sans conséquences. L’ignorance, la peur de l’autre ne sont pas moins répandues ici qu’ailleurs.
Dans ce patchwork de populations et de territoires, jusqu’à la fin du Moyen Âge, la religion catholique fut un ferment d’unité. Unité partielle et excluante cependant, car les individus et communautés qui n’en étaient pas, à commencer par les Juifs, étaient utilisés, persécutés, spoliés. Les Français de ce temps-là ne se concevaient pas autrement que dans le giron d’une Église avec laquelle ils allaient bientôt pourtant prendre leurs distances, via le gallicanisme et surtout le protestantisme, qui marque une rupture fondamentale – peut-être aussi la possibilité du doute. De ferment d’unité, donnant sa légitimité aux institutions et son rythme à l’existence humaine, la religion, désormais divisée en deux, l’une « papiste », l’autre «prétendument réformée », devint un motif de désunion. Réaction spontanée des pratiquants prisonniers de leurs dogmes respectifs ? Nullement ! L’histoire des Croquants du Périgord et du Limousin nous apprend que, même échaudé par trente années de guerres civiles, le menu peuple sut faire fi des différences religieuses et combattre ensemble pour la défense de ses droits et de ses conditions matérielles d’existence. La faute originelle incombe plutôt aux rois. Ainsi François Ier, soi-disant roi-chevalier et protecteur des arts et des lettres, mais massacreur des Vaudois. Ainsi son fils Henri II, qui poursuivit la même politique d’intolérance. Contrairement à la légende noire de Dumas, une femme, Catherine de Médicis, chercha un temps la conciliation entre les cultes. Un quart de siècle après la nuit barbare de la Saint-Barthélemy, dans un pays exsangue, l’Édit de Nantes régla incomplètement le problème religieux. Moins d’un siècle encore plus tard, les protestants eurent le choix de survivre en France comme des sous-sujets… ou d’aller vivre libres ailleurs.

Le massacre de la Saint-Barthélemy, par François Dubois.
Pourquoi ce rappel historique ? Parce que l’histoire nous édifie sur le rapport des Français à la croyance, à la non-croyance, à la diversité des croyances, donc à la tolérance et à l’intolérance. Non que les sentiments des XVIe et XVIIe siècles aient pu se perpétuer jusqu’à nous… l’atavisme a ses limites. Mais il est probable qu’un pays qui a tardivement fait l’expérience du pluralisme religieux, puis a réfuté cette expérience avant de se reconstruire en opposition à la religion, en ait gardé quelques traces. Le mot de «séparatisme » ne peut pas être compris hors de ce contexte, sans avoir égard à ces temps de troubles. Quand je l’entends, je vois apparaître le spectre de la guerre civile dont on prétend précisément nous sauver. Et je songe que dans un pays en paix, il n’a pas lieu d’être.
De nos jours, la place de la religion en France est secondaire. En 2019, 56 % des Français se déclaraient athées, agnostiques ou indifférents à la question. Un gros tiers se déclaraient croyants. Sur cette masse, combien fréquentent l’église, la mosquée ou la synagogue plus d’une fois l’an ? Que de chemin parcouru, dans un pays qui, des siècles durant, vécut au son des cloches !
Alors le surgissement constant du mot « laïcité », désormais, « séparatisme », dans le discours politique, ne laisse pas d’interroger. Sommes-nous revenus en 1905, lorsqu’il fallait affranchir la société de l’Église omniprésente ? Non pas. Dans la France de 2020, mis à part les départements concordataires, l’État est, fort heureusement, strictement séparé des églises. Ne sommes-nous pas plutôt revenus à l’atmosphère de suspicion généralisée qui précéda 1572 ?

Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 par Le Barbier.
Dans leur immense sagesse, les constituants de 1789, qui n’étaient pas encore « républicains », ont proclamé : « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. » Puisque la tendance est à prendre systématiquement cet énoncé limpide par la fin, par le soupçon du « trouble à l’ordre public », je propose pour cette fois de le prendre par le début : « Nul ne peut, etc. »
Depuis belle lurette, chacun sait dans ce pays que lorsqu’on dit «laïcité », on veut dire « islam ». C’est que depuis trente ans, ce sujet est le fonds de commerce de prestidigitateurs en tous genres, martelé sur les estrades des meetings politiques (de droite comme de gauche), imprimé en gras sur les unes des hebdomadaires, seriné en boucle sur les télés et les radios. Le covid-19 nous en avait débarrassé pour quelques mois, le remettant à sa place – une question de société parmi d’autres, ni la moins sensible, ni la plus cruciale – et voilà qu’il revient à nouveau au programme du gouvernement sous une appellation du même tonneau, encore plus anxiogène. Ainsi la menace contre la laïcité ne proviendrait plus de l’institution qui a dominé la vie sociale pendant un millénaire, mais d’une religion parmi d’autres, dans un pays où la religiosité est, par ailleurs, minoritaire. Dans la confusion générale, alimentée par une rhétorique de boutefeux, le dominé d’aujourd’hui a subrepticement pris la place du dominant d’hier. Le discours d’intolérance peut enfin produire tous ses effets.
Personne de sérieux ne niera que se développe, dans les quartiers, un islam sectaire. Personne n’ignore non plus que le terrorisme y prend racine. Est-ce suffisant pour que les Français, ou habitués en France, de confession musulmane, soient désignés comme des dangers potentiels ? Demande-t-on aux catholiques de rendre des comptes pour les intégristes de Civitas et autres organisations similaires se revendiquant de la même religion ? Insidieusement, l’idée répugnante d’une possible incompatibilité entre un culte particulier et une « république » décidément bien intransigeante s’est imposée dans le débat. Est-ce pourtant la spécificité de l’islam, que de contenir en son sein quelques milliers d’individus en rupture de ban ? N’y a-t-il pas dans notre pays quantité de croyants d’autres religions qui vivent, loin des médias borgnes, une existence qui ne sont pas des modèles de républicanisme laïque ? L’appartenance de ces personnes à la communauté nationale ne me paraît pas plus discutable dans un cas que dans l’autre, et la nécessité d’y prévenir les dérives sectaires ne m’en paraît pas moins pressante. On entend par exemple souvent dénoncer, à raison, le contrôle social qui s’exerce sur les jeunes filles, dans certains milieux musulmans rigoristes. Entend-on parler de celui qui s’exerce, avec toute l’apparence de la civilité, dans la meilleure bourgeoisie catholique ? Le patriarcat est-il plus respectable en foulard Hermès qu’en foulard islamique ? Ou alors, c’est que le problème est autre. Peut-être au fond le regard suspicieux sans cesse porté sur l’islam procède moins du risque qu’il ferait courir à des «principes républicains » à géométrie variable que d’une intolérance où se mêlent préjugés de classe et préjugés de « race ».
Dans une récente tribune**, Chems-Eddine Hafiz, recteur de la grande mosquée de Paris, a justement pointé le problème sur lequel Macron tire un cache-misère : la ghettoïsation.
Marginalisez une population déjà stigmatisée par la colonisation, compliquez-lui l’accès au travail et au logement, refusez-lui jusqu’à cette dignité primordiale d’être reconnue dans ses singularités culturelles, et vous verrez ce que vous obtiendrez. Sans doute quelque chose de très semblable à ce que vivent, dans nos banlieues, dans nos quartiers, les filles et fils de la main d’œuvre de l’ex-empire colonial, ces « Français de papier » dont la classe politique fait ses boucs émissaires préférés depuis un demi-siècle au moins. Sans doute aussi la désespérance formera un bon terreau et pour le fait religieux et parfois pour ses formes conservatrices, voire sectaires. Un contexte géopolitique explosif achèvera de plaquer sur chaque jeune de quartier l’image du « séparatiste » en puissance. Sur ce terrain miné, y a-t-il encore la place pour la tolérance et l’entente mutuelle ? Je veux le croire, parce que tout ce qui m’est voisin est mien, parce que tout ce qui m’est proche m’influence. Parce que, comme l’a écrit Michelet : « La France est le pays de ceux que j’aime et que j’ai aimés. »
J’ai été pratiquant, catholique en l’occurrence – baptisé à 9 ans, confirmé à 20. L’eau depuis a coulé sous les ponts, et tout en me défiant des mots qui entravent la liberté spirituelle, je sais que je ne crois pas au sens que l’on attribue généralement à ce verbe. Mon parcours a-t-il atteint son but ? Soyons humble : je l’ignore. Je suis laïque, matérialiste – voilà qui ne devrait pas changer. Pour le reste, chacun emprunte les voies qu’il peut pour trouver sa vérité.
Peut-être cette expérience personnelle, sans m’avoir laissé rien d’autre qu’une sympathie culturelle pour les églises, les cantates et la figure d’un Jésus révolutionnaire, m’a du moins prévenu contre la défiance à l’égard des croyants. En observant le monde et mon pays, je suis forcé de constater que certains de mes frères et sœurs humains trouvent un réconfort moral et spirituel dans la foi et éventuellement la pratique d’une religion. Et tout en étant pleinement solidaire des combats menés contre les dogmes et pour l’émancipation de l’individu et de la société, je n’ignore pas non plus que des chapelles de toutes obédiences ont quelquefois été porteuses de progrès démocratiques et sociaux : ainsi du bas clergé pendant la Révolution, des prêtres ouvriers, etc.
Pourquoi cette digression ? Parce qu’il me semble que si je ressens cela, et si je ne m’en crois ni plus, ni moins légitime à vivre en France que n’importe lequel de mes concitoyens, alors je sais que chacun possède également ce droit à croire et à ne pas croire ce qu’il veut. Et que personne ne peut être tenu suspect de « porter atteinte au vivre ensemble » ou de ne pas respecter les « lois de la République » pour la seule raison de sa foi… comme tout y engage aujourd’hui.
L’air en effet est plein de ces glissements qui nourrissent l’intolérance et font vaciller la raison.
Parmi ces glissements, sémantiques et rhétoriques, il y a ceux de la droite, très classiques, mais revêtus désormais de tous les artifices qui leur donnent une apparence de dignité républicaine – summum de la subversion. Quand un Retailleau, défenseur des crèches dans les mairies, anti-avortement, anti-mariage homosexuel, parle de laïcité et de communautarisme, moi, je ris à m’en tenir les côtes, mais beaucoup tombent dans le panneau. Il y a aussi les représentants de cette « gauche », ou plutôt ex-gauche, qui a fait d’une laïcité pleine de faux-semblants son cheval de bataille, oubliant au passage la lutte sociale qui lui est consubstantielle et indispensable. Par de beaux esprits, on a même vu réfuter le terme d’« islamophobie », au prétexte qu’il empêcherait de critiquer la religion. Dirait-on la même chose de la « judéophobie », dont on sait à quels abîmes elle a mené ? Dangereuses subtilités en vérité. Pour ne pas être l’idiot utile de l’islamisme, faut-il absolument se faire l’agent docile de l’extrême droite ? Tandis que nous développons sans discontinuer sa thématique préférée, Le Pen se frotte les mains en attendant son tour.
Trente ans après l’« affaire du voile », Macron reprend donc les minables calculs qui avaient été ceux de Sarkozy et Hollande avant lui, mais d’une manière plus brutale encore, avec un mot terriblement évocateur. S’il veut lutter contre le sectarisme islamiste, il n’a pourtant pas besoin de puiser dans le lexique de la guerre civile. Il peut mener une action résolue, efficace, sans convoquer tant de mauvais souvenirs, ni ouvrir tant d’effrayantes perspectives. Mais le veut-il vraiment ? S’en donne-t-il les moyens ?, lui qui protège par ailleurs une autre forme de «séparatisme», pour reprendre son mot à meilleur escient, contre lequel la République, bonne mère, ne fait rien: le séparatisme de ceux qui, par leur argent, par leurs réseaux, par leurs savoirs jalousement gardés, échappent à la loi commune, à l’impôt commun, à l’école commune, et détruisent ainsi effectivement le seul espoir de vivre ensemble.
* Publiées dans l’Obs le 25 septembre et dans le Figarovox le 1er octobre.
** Publiée dans Le Monde du 1er octobre.