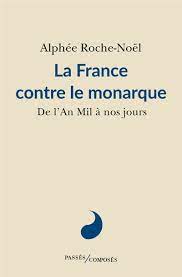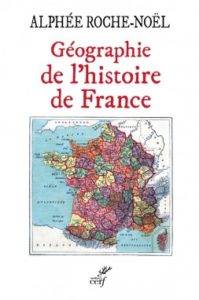« Il va nous falloir beaucoup de patience et d’amour ». Aquarelle originale de Vieuvre – Site internet ici : vieuvre.fr.
Dix jours après l’assassinat terroriste de Samuel Paty, je ressens le besoin d’ajouter ces addenda à un texte publié récemment, « sur le prétendu “séparatisme” ». Il ne s’agit pas de nuances, mais de réflexions supplémentaires, à côté desquelles je n’aurais pas dû passer dans un premier jet qui, comme tout ce qui est fait et écrit en réaction, souffre de lacunes. Ces réflexions sont issues de mon expérience personnelle.
Mon témoignage à cet égard en vaut bien un autre ; il a vingt ans, et rien ne m’a éloigné depuis lors des constats que j’avais faits à l’époque.
Il y a vingt ans, donc, j’étais élève d’un lycée public du nord-est parisien, où se côtoyaient beaucoup de gamins de familles immigrées et modestes et d’autres, disons…, dans un certain écart avec ce que l’institution scolaire nous enseigne comme étant l’exemple de la réussite. J’étais de ces derniers, après des années collège à la dérive.
Excellent lycée en vérité, non pas à cause de son taux brut de réussite au bac, statistique absurde !, mais à cause de l’attention que son équipe pédagogique portait à ses jeunes, à tous ses jeunes ; à cause de cette conviction communément partagée, dans nos classes remuantes où je n’étais pas le dernier à faire le zouave, qu’il était possible de s’élever par le savoir. Ainsi des formidables cours d’histoire-géographie, dispensés par un vieil habitant de la Goutte d’Or à la voix éraillée par la clope, des cours de philosophie, d’économie et de sociologie, traversés de grands débats qui tous nous éveillaient à l’humanité et à la citoyenneté. Je ne citerai pas tous mes profs de l’époque, mais je me souviens de chacun d’entre eux, le cœur gros de gratitude.
En ce temps-là cependant, notre lycée, dans sa diversité culturelle, était aussi traversé par l’actualité géopolitique : en septembre 2000 nous avions vu débuter la Seconde Intifada, lorsque Sharon était allé faire son tour de piste sur l’esplanade des mosquées ; en septembre 2001, nous avions appris, en plein cours de maths, que deux avions de ligne venaient d’être projetés contre les Tours Jumelles. Fracas de la violence qui embrasait le globe, sous nos yeux ébahis d’adolescents.
Dans la franche camaraderie qui régnait globalement dans nos classes, l’histoire du monde, redémarrée quand on la croyait finie, avait réactivé des ferments de division. Soudain chacun devenait acteur d’un scénario qui nous dépassait tous. Oh ! Ça n’allait pas beaucoup plus loin que quelques débats animés dans la cour… souvent chargés toutefois de sentiments identitaires. Tel ou tel s’y qui s’y engageait vigoureusement, soit du côté israélien, soit du côté palestinien, tenait le rôle qui lui avait été assigné par sa culture, arabe ou juive.
Intriqués avec les enjeux géopolitiques, excités par eux, les réflexes communautaires se multipliaient comme autant de signes annonciateurs d’une sale ambiance. J’avais été profondément heurté d’apprendre qu’une mère du quartier avait été agressée parce qu’on la savait, ou pensait, juive. J’avais été stupéfait d’entendre une camarade me dire que le Coca-Cola était une invention des Juifs destinée à empoisonner les musulmans, et de m’entendre en retour déployer des trésors de pédagogie pour démontrer que cette idée était à la fois dangereuse… et invraisemblable (ironie de l’histoire : sa meilleure amie était juive). Les vantardises de rares fortes têtes qui, à 17 ans, parlaient de faire leur Alya et vantaient les prouesses de Tsahal, ne faisaient pas non plus dans la dentelle. Ce sont-là des souvenirs parmi beaucoup d’autres, embrouillés par le temps, mais qui formaient un bruit de fond quotidien où humour et animosité jouaient à touche-touche. Parmi les références identitaires (les Renois, les Toubabs…), la dimension religieuse tenait une part non négligeable : beaucoup de mes amis faisaient ou ne faisaient pas telle chose parce que, dans le système de valeurs où ils avaient été élevés, islamiques, hébraïques, parfois évangéliques, la religion, ou l’idée qu’on se faisait de la religion, le leur permettait ou le leur interdisait – c’était haram, c’était péché. Fallait-il s’en étonner, venant de jeunes «issus de l’immigration » ? Mon établissement n’était pas un lycée ghetto, mais un lycée mélangé, comme d’autres alors aux marges de la capitale. Nombre d’élèves venaient de familles athées, ou de cultures asiatiques, ou n’accordaient pas la même importance à la religion. On les entendait moins cependant : la mode tendait à une affirmation plus marquée des « religions du livre » et, parmi elles, des deux représentées, à tort, comme antagoniques, par une lecture civilisationnelle, de plus en plus banalisée, de l’histoire humaine.
Il se trouve que ces années lycée ont été encadrées par deux de ces événements qui font une génération : la victoire de l’équipe de France « black-blanc-beur » de 1998 et l’accession au second tour de Le Pen père en 2002. Les semaines de révision du bac avaient été le temps d’un autre apprentissage de la citoyenneté, dans la rue, où nous nous étions massivement rendus dans l’entre-deux tours.
De cette période, je ne sais s’il faut retenir les beaux souvenirs ou les désillusions. Sans doute les deux, en bloc, car il n’y a guère que dans la complexité qu’on se forge une expérience efficace.
Au lendemain de mon dix-huitième anniversaire, intervenu peu après la présidentielle, je m’étais plus résolument rapproché du PS, autour duquel je gravitais depuis un moment, me jurant de ne jamais manquer aucune élection. Et cependant quelque chose me gênait dans cette gauche trop pudique, trop aveugle, me semblait-il, pour intégrer à son logiciel, en même temps que les inégalités, l’emprise croissante du religieux et du communautaire sur les jeunes des quartiers populaires, de plus en plus livrés à eux-mêmes, de plus en plus éloignés de la République.
Ce temps singulier était aussi celui des Territoires perdus de la République et des débats autour du rapport Obin, qui corroboraient mon propre vécu. Au milieu des années 2000, redoutant la fracturation attendue du pays, je m’étais rallié à un discours de droite, qui me paraissait plus clair sur ces enjeux – il me fallut dix ans pour commencer d’en sortir.
Ceci n’est pas tout à fait une autre histoire, et si je le mentionne, c’est pour dire que c’est en toute connaissance de cause que je dénonce aujourd’hui la rhétorique des boutefeux. Je sais trop leurs objectifs et leurs manœuvres pour admettre simplement leurs prémisses. Je me souviens d’une époque où l’on entendait parfois, et pas seulement dans les sketchs des Inconnus, cet axiome terrible : « le problème de Le Pen, c’est qu’il pose le bon diagnostic, mais il ne propose pas les bonnes solutions ». Puisque nous sommes résolus à demeurer, j’insiste sur le terme !, à ce niveau d’indigence intellectuelle, je crois nécessaire d’affirmer pour ma part que je réfute et les solutions, et le diagnostic. Et d’ajouter que tant que nous ne serons pas d’accord sur ce postulat que c’est l’inégalité, sous toutes ses formes, qui atomise la société, alors nous ne serons d’accord sur rien.
Précocement alerté, donc, sur la réalité du repli communautaire, attentif de longue date aux menées des islamistes dans les quartiers, je n’en pense donc pas moins que nous avons, collectivement, pris le problème complètement à l’envers.
Je crois en effet qu’en suivant perinde ac cadaver les discours d’intransigeance, parfois d’intolérance, qui nous enjoignaient de nous focaliser sur le signe, nous avons occulté le fait. Nous avons accepté cette idée folle que l’islamisme, tel qu’il se développe, pourrait être sans lien avec la ghettoïsation et la ségrégation (c’est là un des seuls mots justes que je reconnais à Valls, qui a aussi dit cette horreur : « expliquer c’est déjà excuser »). Ce faisant nous avons renoncé à adosser tout discours sur la citoyenneté, et particulièrement sur la laïcité, à une critique tout aussi forte et performative de l’inégalité économique et sociale. Et ce faisant, nous avons renoncé même à cette République dont nous prononçons plus souvent le nom que nous ne lui donnons du sens.
Je crois également qu’en nous focalisant sur le signe, nous avons porté le combat laïque sur le terrain du symbolique et tendu ainsi les verges pour nous faire battre. Nous fut-il par exemple profitable de nous arc-bouter trente années durant sur le voile, quand tant de sujets bien plus graves étaient en jeu, qui portaient autrement atteinte à la liberté de l’enseignement, à la liberté de conscience, à l’égalité femme-homme ? À moins de considérer que la moindre manifestation de foi islamique conduise immanquablement à l’islamisme – syllogisme pervers mais de plus en plus répandu… Parallèlement l’islamisme se servait de ce voile, que nous avions imprudemment mis au cœur du débat, comme d’un point d’accroche. Voici comment, d’un sujet vestimentaire, on fait un sujet idéologique. Il faut lire à cet égard l’excellente tribune de la sociologue Agnès de Féo*, spécialiste de la question des femmes islamistes. Elle y souligne notamment l’« isolement [des femmes portant le niqab] dans une “communauté musulmane” où elles ne sont pas forcément acceptées, car elles mettent à mal l’image du groupe ». À méditer, peut-être ?
Sur ce dernier point justement, je crois que, d’erreur stratégique en erreur stratégique (mais sont-ce des erreurs… ?), nous avons rendu plus difficile la réforme de l’islam de France que chacun appelle désormais de ses vœux, désignant sans complexe le général, quand ce qui est en cause est le particulier.
Un peu d’humilité à cet égard nous ferait concevoir qu’il existe, dans les trois religions monothéistes, des courants réformistes qui pourraient éventuellement profiter de ce que leur religion ne soit plus systématiquement assimilée à de l’obscurantisme pur et simple. On pourrait par exemple s’intéresser à ces femmes qui font, justement, évoluer de l’intérieur un islam qui sous certains aspects, en a bien besoin… comme le catholicisme et le judaïsme. Elles sont l’exception ? Il nous appartient de ne pas les empêcher de faire la règle. Faut-il du reste s’étonner que les trois « religions du livre », toutes issues du patriarche Abraham, soient, par construction, patriarcales ? Non. Mais il faut se réjouir en revanche que des femmes candidatent pour être primat des Gaules… et que d’autres se fassent imams ou rabbins, ou, bien sûr, pasteurs, de leur propre mouvement. L’absence de hiérarchie, si souvent critiquée, a au moins ce mérite de permettre à des croyantes engagées, à force de lutte, d’atteindre à des fonctions qui leurs sont fermées depuis 2000 ans dans une Église prétendument «catholique », c’est-à-dire universelle, mais qui persiste à refuser la prêtrise à la moitié de l’humanité.
Faut-il également suggérer que, par des obsessions dont les ressorts ne sont pas tous avouables, nous générons des conflits de loyauté qui n’ont pas lieu d’être ? En sommant toujours les musulmans de France de faire leur aggiornamento, voire en questionnant, en des mots plus ou moins choisis, la compatibilité de l’islam avec la République, on n’excite pas seulement l’esprit d’imitation ou de provocation de quelques-uns, on crée aussi un coin chez un bien plus grand nombre, entre la sensibilité personnelle et les devoirs sociaux. Dans l’histoire, ce type de stratégie n’a pas porté les meilleurs fruits. Ainsi, en 1789, la Constitution civile du clergé a fini par pousser dans les bras de la contre-révolution des milliers de catholiques, qui, avant d’être convaincus qu’ils ne pouvaient pas être à la fois fidèles à l’Église et fidèles à la Nation, étaient acquis aux idées d’égalité et de liberté. Comparaison n’est assurément pas raison, mais en matière de religion, de culture, de sentiment d’appartenance, la sensibilité humaine ne peut pas être ignorée, si tant est qu’on veuille, de bonne foi, vivre tous ensemble. Pour combattre l’islamisme, il faut d’abord et avant tout l’isoler complètement de la foi sur laquelle il prétend prospérer. Se défier des amalgames n’est pas une pudibonderie, c’est une nécessité.
Pour revenir à mon expérience lycéenne, autant je me rappelle les signaux inquiétants que j’ai dits, autant je me rappelle que, lorsque nous étions en classe, face à l’explication, parfois maïeutique, d’un ou d’une professeur·e, l’écrasante majorité des gamins, dont je faisais partie, se sentaient devenir plus intelligents. Par la plupart de ces enseignants, passionnés, passionnants, la plupart des bravades étaient réduites à ce qu’elles étaient, c’est-à-dire pas grand-chose, et la plupart des questions recevaient des réponses éclairantes. Et nous avons appris, et nous nous sommes élevés. Et si, faute d’avoir eu les mêmes chances au départ, nous n’avons pas pu avoir les mêmes chances au point où nous sommes arrivés, nous sommes en tout cas plus forts d’avoir reçu cette instruction républicaine, par des femmes et des hommes plus soucieux de l’impératif de l’éducation que des signes agités comme des chiffons rouges.
Si ce miracle est encore possible, dans un pays où l’on a dit « après le pain, l’éducation est le premier besoin du peuple », alors il faut tout mettre en œuvre pour qu’il puisse se produire, partout, tout le temps.
Quant au terrorisme : nous l’avons subi par le passé et continuerons de le subir. Aucune loi ne nous en préviendra complètement ; la surenchère en la matière n’a pas de fin et c’est pourquoi il faut s’en méfier comme de la peste. Faut-il donc avoir peur ? Non. Rapporté à la population générale, le risque de succomber à un acte de cette sorte est infinitésimal… même si l’on ne peut récuser ce fait que les menaces ciblées font peser plus de risque sur ceux qui s’engagent. Mais en matière d’atteintes à la liberté d’expression, en a-t-il déjà été autrement ? Interrogeant en tout cas l’attitude à adopter face à la menace, voire face au crime perpétré, il est urgent de concevoir que, dans le conflit qui oppose le fort au fou, la multitude à quelques poignées d’individus, ce mode d’action criminelle parvient à ses fins uniquement en suscitant l’effroi. Il se sert de notre emballement comme on se sert en jiu-jitsu de la force d’un adversaire pour le mettre au sol. Il n’est pas dit cependant qu’une autre politique de sécurité ne puisse pas mieux nous en garantir : la suppression du renseignement territorial, la réduction des effectifs par les spécialistes ès coups de menton sont sans doute pour beaucoup dans la difficulté à anticiper la menace.
Comme souvent, comme toujours, il y a les mots… et il y a les actes.
*Le Monde du 22 octobre 2020.