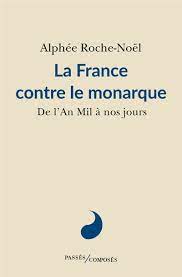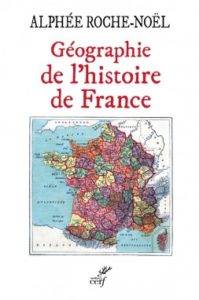Partout en France, pendant les fêtes, des cheminots continueront de faire grève pour protester contre la casse des retraites. Certains ont même refusé de suivre leurs centrales syndicales qui avaient topé avec le gouvernement sur le principe d’une trêve de Noël.
Partout en France, pendant les fêtes, des cheminots continueront de faire grève pour protester contre la casse des retraites. Certains ont même refusé de suivre leurs centrales syndicales qui avaient topé avec le gouvernement sur le principe d’une trêve de Noël.
De ces travailleurs et travailleuses du rail, les ministres et leurs petits télégraphistes des médias ont fait des ravisseurs d’enfants, qui empêchent les honnêtes gens de réveillonner en famille. Comme les gilets jaunes avant eux, ils ont été calomniés par des notables prêts à tous les expédients. Outré par les « privilèges » des petites gens, Schoettl, conseiller d’État honoraire et ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, a même appelé à supprimer le droit de grève dans les services publics[i] – autant dire le droit de grève tout court. Pourtant, il faut le dire : à l’heure où les Saint Jean bouche d’or cherchent de nouveaux héros à donner en exemple à la société, ceux-ci pourraient être trouvés sur le réseau ferroviaire national, parmi celles et ceux qui sacrifient leur paye pour défendre les conquis sociaux.
Les annonces gouvernementales sur le saucissonnage générationnel de la réforme ont prouvé que les cheminots ne se battent pas pour eux-mêmes, mais pour leurs successeurs. Que leurs motifs ne sont pas catégoriels, mais universels. Un récent article du Monde[ii] fait d’ailleurs témoigner des quidams de toutes professions, employés sous des statuts plus ou moins précaires, qui affirment d’une seule voix : « nous ne pouvons pas nous permettre de faire grève, mais nous soutenons la mobilisation. »
Voilà la vérité d’un mouvement social qui, sondage après sondage, rassemble un nombre croissant d’opinions favorables. On se rappelle les mots de Villepin en 2005 : « J’entends ceux qui manifestent, mais j’entends aussi ceux qui ne manifestent pas ». Quinze ans plus tard, le mensonge de la « majorité silencieuse » s’est retourné contre ses inventeurs : une majorité solide de nos concitoyen·ne·s soutient la grève et fait la part des choses entre une gêne ponctuelle et les nécessités d’une guerre plus longue contre les démolisseurs de la République sociale.
C’est que le présent combat dépasse le droit de chacune et chacun de vieillir dans la dignité. De fait, il s’emboîte dans l’année jaune et donne à toutes les convergences opérées depuis lors, sur le climat, sur l’école ou encore sur l’hôpital, une dimension constituante qu’avaient perdue les luttes institutionnelles de la fin du XXe siècle. En cette veille de « grève des confiseurs », personne ne peut savoir jusqu’où ira le mouvement. Une seule chose est sûre : comme l’an dernier et quelle que soit sa forme, il ne s’éteindra pas tant que les termes du contrat social n’auront pas été remis en discussion.
[i] Le Figaro du 20 décembre.
[ii] Daté du 23 décembre.
Publié dans la Feuille constituante du 23 décembre 2019.



 Mercredi 27 novembre, la Commission Von der Leyen sera investie par le Parlement européen. Sera ? Sans doute, les partis décatis qui régentent encore l’UE ayant intérêt à soutenir les commissaires issus de leurs rangs. On rappellera toutefois que la candidature de l’ex-ministre de la défense de la RFA, proposée, comme celle de tous ses prédécesseurs, à l’issue d’un processus des plus opaques, avait manqué de peu d’être retoquée par les mêmes députés en juillet dernier. Une intrigue de plus, dans un imbroglio dont nous sommes les affligés spectateurs.
Mercredi 27 novembre, la Commission Von der Leyen sera investie par le Parlement européen. Sera ? Sans doute, les partis décatis qui régentent encore l’UE ayant intérêt à soutenir les commissaires issus de leurs rangs. On rappellera toutefois que la candidature de l’ex-ministre de la défense de la RFA, proposée, comme celle de tous ses prédécesseurs, à l’issue d’un processus des plus opaques, avait manqué de peu d’être retoquée par les mêmes députés en juillet dernier. Une intrigue de plus, dans un imbroglio dont nous sommes les affligés spectateurs.
 L’Europe et l’Angleterre sont dans un bateau.
L’Europe et l’Angleterre sont dans un bateau.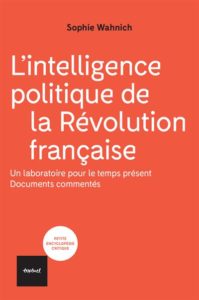 Le 14 juillet 1989, la Révolution française commémorée paradait sur les Champs-Élysées, joyeux carnaval marketing imaginé par un publicitaire. Depuis lors, la matérialité de l’histoire nous est revenue en boomerang, révoquant les idées désincarnées. La société du chômage a engendré celle de la précarité ; les structures qui tenaient la nation une et indivisible se sont dissoutes dans le grand marché ; les contradictions sont apparues, flagrantes, entre le cadre césariste de la Ve République et l’aspiration populaire à une démocratie réelle. Trente ans plus tard, la Révolution française est retournée sur les Champs-Élysées, mais sous une forme bien plus authentique, bien plus conforme à l’élan originel, portant de nouvelles revendications démocratiques et sociales.
Le 14 juillet 1989, la Révolution française commémorée paradait sur les Champs-Élysées, joyeux carnaval marketing imaginé par un publicitaire. Depuis lors, la matérialité de l’histoire nous est revenue en boomerang, révoquant les idées désincarnées. La société du chômage a engendré celle de la précarité ; les structures qui tenaient la nation une et indivisible se sont dissoutes dans le grand marché ; les contradictions sont apparues, flagrantes, entre le cadre césariste de la Ve République et l’aspiration populaire à une démocratie réelle. Trente ans plus tard, la Révolution française est retournée sur les Champs-Élysées, mais sous une forme bien plus authentique, bien plus conforme à l’élan originel, portant de nouvelles revendications démocratiques et sociales.