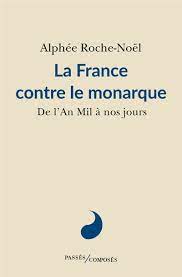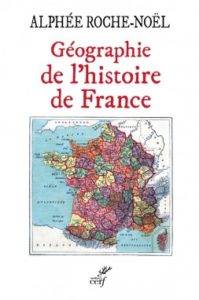Printemps 2023 ;
la France traverse une grave crise démocratique. D’un coup d’un seul, tous les défauts de la V
e République remontent à la surface ; l’inadéquation de ce régime constitutionnel à la société présente apparaît au grand jour.
Le recours au 49.3 pour faire passer en force l’injuste réforme des retraites a joué le rôle du révélateur.
Dorénavant,
chacun peut voir que le peuple français n’a pratiquement plus de part à l’élaboration des décisions qui le concernent. Sans cela, comment expliquer qu’une loi rejetée par une si large majorité de citoyennes et de citoyens ait pu être adoptée, promulguée, et même seulement considérée par les gouvernants comme une option possible ?
Chacun peut voir également que le peuple n’a plus les moyens de remettre en cause les politiques qui lui portent préjudice : la manifestation est inopérante, les recours légaux sont voués à l’échec.
À l’arrivée, la situation politique est bloquée de bout en bout, en raison tant de la
configuration politique issue de la séquence électorale de 2022 que du
système institutionnel lui-même.
1/Pour résoudre la crise démocratique, il faut restaurer et les conditions du consentement populaire et la puissance d’agir en commun
C’est donc une affaire entendue : la crise actuelle trouve son origine dans un défaut général de consentement*, consentement que Macron a cru acquis une fois pour toutes lorsqu’il ne lui avait été accordé que dans la circonstance particulière de ses deux duels face à Le Pen au second tour de l’élection présidentielle. À quoi il faut ajouter, pour être complet, que ce consentement était très abîmé dès avant 2017, du fait d’une longue succession de promesses non tenues et de renoncements de tous ordres depuis le « non » escamoté au traité constitutionnel de 2005.
Dès lors, une série de conclusions successives s’imposent d’elles-mêmes à l’esprit comme autant de lapalissades. Ces évidences, il n’est pas inutile de les exposer, afin d’avoir les idées bien au clair.
1° pour sortir de la crise, il faut restaurer les conditions du consentement populaire ;
2° pour restaurer les conditions du consentement populaire, il faut démocratiser le régime constitutionnel, donc réformer/réécrire la Constitution ;
3° sauf à vouloir l’enterrer dès l’origine, cette démocratisation du régime ne doit à aucun prix porter atteinte à la puissance d’agir en commun. Au contraire, il s’agit de retrouver – ou de découvrir… – cette efficace, au service de l’intérêt général, entendu ici comme l’application, au bénéfice de toutes et tous, de l’environnement et du vivant, d’un triple principe de justice sociale, écologique et sociétale.
À condition qu’on les aborde avec sérieux, les deux termes de la proposition – consentement populaire, puissance d’agir en commun – ne sont nullement contradictoires, bien au contraire ; j’y reviendrai.
Certainement, on se fourvoierait en croyant trouver le Graal, la pierre philosophale ou que sais-je encore de chimérique dans quelque dispositif constitutionnel que ce soit.
Quiconque d’ailleurs croirait possible d’améliorer la société en touchant à ses « lois fondamentales » aurait avantage à se montrer prudent dans ses procédés et modeste dans ses attentes : en la matière, l’espérance déçue peut être plus redoutable que l’espérance insatisfaite.
Pour autant, il faut bien admettre que toute société est nécessairement conduite, à certains moments de son histoire, à rechercher de nouvelles manières de se constituer ou de se reconstituer, ceci pour acter certaines évolutions ou dépasser certaines crises.
Or nous vivons précisément un tel moment.
2/Parmi les partis politiques, seule la coalition de gauche a intégré l’urgence de la réforme démocratique
Au global, la classe politique semble avoir à peu près identifié ces enjeux. Les a-t-elle pour autant compris ? C’est à voir, cela dépend des cas. Ainsi, si plus aucun parti ne semble faire comme si de rien n’était, la plupart d’entre eux laissent toutefois le régime glisser sur sa pente naturelle, voire l’y poussent. Cette pente, précisons-le, peut avoir plusieurs déclinaisons, toutes inscrites comme des destins possibles dans l’ADN de la Ve République : présidentialisation assumée ; mue autoritaire (sous couvert de l’appel au peuple) ; démocratisation de second rang. (NB : les trois issues ne sont pas forcément incompatibles.)
Naturellement, le « groupe de travail transpartisan » de la présidente Braun-Pivet, largement diversif, ne changera rien à l’affaire. « Jupitérien » impénitent, Macron ne modifiera aucunement ses vues sur le pouvoir : son fondement, son exercice, son organisation ; l’expérience nous en convainc.
Une seule force politique se détache franchement du lot : la coalition de gauche, avec son projet de VIe République, porté en 2012, 2017 et 2022 par le candidat Mélenchon et repris, après cette dernière échéance, dans le programme de la Nupes. Avec, à la clef, plusieurs modalités envisageables : la convocation d’une assemblée constituante – c’était la position traditionnelle de LFI – ou la réunion d’une convention citoyenne.
Au regard de l’intention affichée, la coalition de gauche semble donc se placer à la hauteur de la situation, en termes de projet et de méthode, ouvrant ainsi la perspective d’une solution légale, soit par le mécanisme des élections, soit par l’accompagnement idéologique d’un événement constitutionnel de type convention citoyenne.
Voyons maintenant ce qu’il en est du fond de ce projet, tel qu’il apparaît dans les plus récents documents programmatiques de la Nupes – vieux d’une année déjà.
3/Le projet de VIe République porté par la Nupes doit être précisé et complété pour devenir un véritable programme constitutionnel
Dans son épure, la VIe version Nupes (et donc, originellement, version LFI) propose l’« abolition de la monarchie républicaine » et l’« établissement d’un régime parlementaire stable ». Je ne crois pas utile d’entrer ici dans le détail des propositions (scrutin proportionnel, fin du parlementarisme rationalisé…). Je me contenterai de rappeler que l’idée d’ensemble s’inscrit dans une tradition issue de la Révolution française, principalement forgée, en matière constitutionnelle, dans le combat contre l’exécutif (c’est-à-dire contre le spectre de la monarchie). Historiquement, nul républicain ne renierait une telle filiation. C’est celle-là même qui conduisit Mendès, Mitterrand et le PCF à critiquer les modalités d’avènement du régime gaullien et sa philosophie générale lorsque celui-ci allait être porté sur les fonts baptismaux.
Cependant, au point où nous sommes de la crise démocratique, nous ne pouvons plus en rester au stade de l’épure, ni encore moins demeurer prisonniers d’une tradition constitutionnelle passée.
Au vrai, la formule même du « régime parlementaire stable » interroge. S’agit-il de retourner à une IVe quelque peu fantasmée, version Mendès ? De faire un pas de côté vers nos voisins européens ? À regarder derrière nous (l’expérience à la fois glorieuse et tragique de la IVe), comme autour de nous (les difficultés des régimes parlementaires partout en Europe), ce slogan n’est pas très engageant en tant que tel. Sauf à être précisé, donc complété, voire réinventé, au moyen d’un ou plusieurs éléments nouveaux – ou préférablement d’un système d’éléments nouveaux.
4/Pour restaurer les conditions du consentement, le RIC, qui figure dans le projet LFI/Nupes, paraît incontournable
Nous en arrivons au contenu véritablement neuf du programme LFI/Nupes, parmi d’autres types d’intervention populaire : le référendum d’initiative citoyenne, proposé depuis 2012 par le candidat Mélenchon, nettement précisé depuis lors. (NB : je ne mentionne pas ici des options propres aux partis composant la Nupes, comme la Chambre du futur, portée part des écologistes, qui pourrait à plusieurs égards entrer dans mon point 5/ ci-apres.)
Ancien comme la Révolution française et cependant encore en avance d’une ou plusieurs réformes démocratiques, déjà pratiqué en de nombreux endroits du monde – en Suisse, notamment –, mantra des gilets jaunes en 2018, ce RIC devenu si emblématique a vocation à devenir un dispositif important dans une future architecture institutionnelle. Permettre une traduction légale et politique des mobilisations populaires, à travers le droit du peuple d’intervenir dans le débat public pour proposer ou contrer une loi, révoquer un élu ou engager une révision de la Constitution, est assurément une exigence démocratique de premier ordre. Plus encore après la faillite du référendum d’initiative partagée, dont les conditions par trop restrictives ont été démontrées en 2019 sur ADP et tout récemment sur la loi « retraites ».
Pour autant, sera-ce assez pour résoudre la crise du consentement dans un cadre préservant la puissance d’agir en commun ? S’il paraît difficile de répondre catégoriquement à cette question, considérons néanmoins le fait que, quand bien même la société s’accoutumerait au RIC au point de l’utiliser fréquemment, ce dispositif n’en resterait pas moins un élément unique et ponctuel de démocratie directe dans un système d’éléments appartenant au régime dit « représentatif » et fonctionnant de manière continue. Partant, on peut formuler l’hypothèse que le RIC ne sera vraiment efficace et vraiment durable que dans la mesure où il sera adossé à une évolution profonde du système représentatif.
5/Restaurer les conditions du consentement suppose parallèlement de transformer les institutions représentatives pour y faire enfin entrer le peuple
À ce stade et après nous être efforcés d’avancer pas à pas, on me permettra une assertion brutale, à savoir que s’il est envisageable – et, par ailleurs, souhaitable – d’intégrer des formes de démocratie directe à notre système politique futur, il paraît en revanche inenvisageable – ni même souhaitable –, à échelle constante, de fonder ce système politique uniquement ou même principalement sur une base de démocratie directe.
Une fois ces prémisses admises, on conviendra que l’enjeu n’est pas tant de faire exister des formes résiduelles de démocratie directe à côté (ou en face) des institutions, mais de changer, au moins en partie, les termes de la représentation, de sorte que de symbolique et en grande partie artificielle, celle-ci en vienne à rendre fidèlement compte de la réalité des forces sociales. Dit autrement, il s’agit de faire entrer le peuple dans les institutions, de l’y rendre vraiment présent, de supprimer, autant qu’il est possible, la frontière qui sépare la société politique de la société réelle. (NB : par peuple, j’entends ici l’ensemble des citoyen·ne·s et des travailleur·euse·s. Je tiens en effet pour acquis qu’il n’est plus possible de se contenter de la fiction d’une représentation assurée uniquement par des professionnels de la politique, quelle que soit leur valeur et la qualité de leur engagement individuels et collectifs.)
6/Pour faire entrer le peuple dans les institutions, le dispositif des assemblées délibérantes permanentes tirées au sort semble être la voie la plus appropriée
Ceci, on le pressent, n’a rien d’une digression métaphysique. C’est en effet précisément à cet embranchement de notre réflexion que nous nous apprêtons à en retrouver le cours principal, à travers le dispositif des assemblées permanentes tirées au sort.
L’objet de la présente note n’est pas de rentrer à fond dans la défense de cette idée à la fois antique et novatrice. Il existe sur ce point une littérature abondante et de nombreux militants en parleraient bien mieux que moi.
Aussi me borderai-je à 1° un constat, 2° une observation 3° et une proposition opérationnelle empruntée au collectif qui l’a ingénieusement forgée : Sénat Citoyen.
Ainsi, je crois être en mesure d’avancer prudemment.
1° Le constat, c’est l’expérience institutionnelle que nous avons pu tirer des assemblées tirées au sort à travers les conventions citoyennes sur le climat et sur la fin de vie.
Ces conventions citoyennes ont prouvé que la chose était possible – ou du moins nous l’ont rappelé, si l’on n’a pas perdu le souvenir de la démocratie athénienne.
Elles ont certes connu des échecs (quelle institution n’en connaît pas ?), mais ceux-ci, les plus significatifs en tout cas, ne leur appartiennent pas en propre : ils procèdent du contexte institutionnel où l’expérience a pris corps – pour faire très court : la « monarchie républicaine », le parlementarisme rationalisé, la technocratie, les lobbies.
2° L’observation est double.
a/Pour la première fois peut-être dans l’histoire des régimes représentatifs français, les classes populaires ont à peu près pesé, dans le sein même d’une assemblée délibérante – certes purement consultative, mais c’est un autre problème –, le poids qu’elles pèsent effectivement dans la société réelle.
À ce sujet, faisons plutôt parler les chiffres :
–> 40 à 45 %, c’est la proportion d’ouvriers et d’employés parmi la population active ;
–> 7 %, c’est la proportion d’ouvriers et d’employés siégeant à l’Assemblée nationale ;
–> 25 %, c’est la proportion d’ouvriers et d’employés ayant siégé dans la Convention citoyenne sur le climat.
Je me limite à ce seul exemple des catégories socio-professionnelles parce qu’il est particulièrement illustratif, mais on pourrait démultiplier les comparaisons, selon l’origine géographique, le niveau de diplôme, l’âge, le sexe. Toutes, en termes de représentation, seraient à l’avantage du tirage au sort.
b/Cette assemblée citoyenne a été capable de produire en quelques mois, sur un sujet majeur, un corpus de propositions audacieux, inventif, adapté sous maints aspects aux défis de notre temps. Si nous n’en avons pas vu l’application, c’est, faut-il le rappeler ? parce que ce corpus a été savamment passé à la moulinette de la technocratie et du parlementarisme rationalisé. Il y a tout lieu de penser qu’une même assemblée, formée à titre permanent dans une architecture institutionnelle conçue pour la recevoir, produirait ses pleins effets.
3° La proposition, c’est de faire de ce dispositif des assemblées délibérantes permanentes tirées au sort l’élément-clef d’un programme constitutionnel. C’est-à-dire de prévoir l’intégration à nos institutions du modèle de la convention citoyenne tirée au sort sur une base permanente, avec des pouvoirs d’initiative, de contrôle, de censure et de garantie des droits d’initiative citoyenne.
Ceci justement est appelé à s’articuler avec le RIC : le peuple proposant, délibérant, contrôlant tout à la fois dans les institutions et hors ces mêmes institutions. Les deux s’accompagnent en s’équilibrant.
Une déclinaison particulièrement intéressante de ce dispositif a été développée par le collectif dont je parlais plus haut, Sénat Citoyen, dont le principe, tiré de son Manifeste, peut être résumé ainsi :
« pour tout pouvoir constitué, exécutif et/ou assemblée élue, il existe une assemblée citoyenne tirée au sort qui questionne, fait des propositions et contrôle ce pouvoir ».
Donc : une seconde assemblée tirée au sort au niveau national et, sur le même modèle, des assemblées tirées au sort au niveau des territoires.
Je laisse les démocrates curieux se rendre sur le site du collectif Sénat Citoyen, prendre connaissance de la proposition de loi constitutionnelle qui s’y trouve et se faire leur propre opinion.
J’en reviens pour ma part au point de départ du mon raisonnement, qui m’amène aussi, progressivement, à sa conclusion.
7/La restauration de la puissance d’agir en commun procède de la restauration des conditions du consentement
Je l’ai assez répété : on ne résoudra pas la crise démocratique si l’on ne restaure pas, dans un même mouvement, et les conditions du consentement populaire, et la puissance d’agir en commun.
Par le passé, nos républiques ont souvent cherché à faire coexister ces principes ; rarement elles y sont parvenues ; ce n’est pas le lieu de restituer le détail de cette histoire.
Dans notre expérience constitutionnelle la plus récente, cette quête et ces échecs ont abouti, après maints rebondissements, à l’établissement puis à l’installation dans la longue durée de la Ve République, donnant l’illusion d’une sorte de fin de l’histoire républicaine fondée sur un prétendu équilibre entre la souveraineté populaire – contenue essentiellement dans l’élection présidentielle au suffrage universel direct – et l’efficacité gouvernementale.
Soumis à des contradictions équivalentes (non pas en qualité, mais en quantité) à celles qui avaient fait exploser la IVe République, ce mythe gaullien vient de voler en éclat.
La IVe avait eu la Guerre froide et la décolonisation ; nous avons une crise protéiforme, sociale, écologique, sociétale, technologique, d’une nature inédite, d’une ampleur inouïe. Aucun régime ne sort indemne d’une telle succession de chocs, qui à maints égards agissent comme des révélateurs : révélateurs de l’instabilité gouvernementale sous la IVe ; révélateurs de la déconnexion et de la délégitimation d’un exécutif réputé pour sa stabilité sous la Ve. Les maux sont différents, les implications sont apparemment différentes, mais, au total, la crise sous-jacente est toujours une crise du consentement.
S’il en est ainsi, c’est que, loin d’être des valeurs nécessairement opposées ou même hiérarchisées, le consentement et l’efficace – disons, le demos et le kratos – doivent aller de pair. Mieux : le premier contient le second, il en est la condition nécessaire et suffisante.
C’est une vérité d’une extrême banalité que d’affirmer qu’en démocratie, l’efficacité de la loi procède du consentement des citoyens-sujets de droit. Et cependant il est bon de rappeler cette vérité.
Or il se trouve qu’y compris dans leurs expressions les plus démocratiques, nos républiques n’ont jamais complètement cessé d’adhérer à la vieille conception de la sanior pars, selon laquelle certains sont fait pour gouverner, d’autres, pour être gouvernés. Autrement dit : dans notre histoire la plus longue, les conditions proprement institutionnelles du consentement n’ont jamais été remplies que de manière très fugace.
Il est temps de passer à autre chose, d’aller trouver le consentement à sa source, dans la réalité d’une société appelée à siéger dans ses propres institutions.
Résumons-nous.
1° il est clair que les modalités d’élaboration du consentement ne peuvent plus être envisagées au seul prisme du régime représentatif tel que celui-ci a été compris jusqu’aujourd’hui.
2° il n’est pas moins clair que le principe de la représentation ne doit pas être abandonné mais réévalué, réinterprété. La pratique des assemblées tirées au sort, dans le cadre proposé ci-dessus, travaillant dans un double rapport de séparation et de coopération avec des pouvoirs élus redevenus de véritables commis de confiance – non pas pour les bouleverser inconsidérément, mais pour les aiguillonner, les contrôler, les dépasser parfois –, s’impose à l’intelligence comme un pas à franchir pour faire retrouver le consentement et, du même coup, l’efficace.
Ce serait un petit pas pour les partis qui consentiraient à s’en approprier l’idée, au prix certes d’un aggiornamento, mais ce serait surtout un pas de géant pour la démocratie qui en tirerait les fruits.
8/Il appartient à la coalition de gauche de forger son programme constitutionnel en puisant dans les propositions de la société civile
Nous avons passé suffisamment de temps sur le fond ; venons-en à la méthode.
Sur ce chapitre, à l’heure qu’il est, trois choses sont à peu près certaines :
1° nous ne pouvons pas savoir si la réforme démocratique adviendra (qu’on l’appelle ou non « VIe République ») ;
2° nous ne pouvons pas plus prévoir les modalités de son éventuel avènement ;
3° nous pouvons toutefois pressentir qu’elle ne sortira pas « tout armée » d’une assemblée constituante/d’une convention citoyenne : qu’elle devra d’abord avoir été préparée, élaborée, sinon dans ses modalités les plus précises, du moins dans ses principes directeurs. Si j’étais provocateur, je dirais qu’il faut à la démocratie son « discours de Bayeux ». Un discours de Bayeux inversé, bien entendu. En tout cas une vue d’ensemble, convaincante et par conséquent rassurante, sur le contenu et les conditions du passage à une démocratie plus complète.
Ici, les partis peuvent retrouver leur rôle dans la formation des idées politiques, et pousser ce rôle à fond… pour autant qu’ils consentent à réévaluer quelques-unes de leurs conceptions, notamment quant aux conditions de formation et d’expression de la souveraineté populaire.
La gauche, sur qui repose, depuis le printemps 1789, toute la charge de l’imagination politique, est plus que jamais placée devant ses responsabilités.
Si sa coalition n’est pas au rendez-vous, alors, qui le sera ? Ne perdons jamais de vue que l’extrême droite est, quant à elle, parfaitement au clair sur ses idées, et d’ailleurs parfaitement duplice dans ses discours. Ainsi prétend-elle elle aussi répondre à la crise du consentement et de l’efficace… mais en maintenant le pouvoir dans la forme que lui a donnée la Ve République, adossé, pour faire bonne mesure, à une pratique référendaire du type « miroir aux alouettes ».
Sur ce point, les choses peuvent évoluer en bien.
Par exemple, la Nupes, à l’Assemblée nationale, a mis en place un groupe de travail qui examine les voies du passage à la VIe République. Ce groupe, animé avec talent par Raquel Garrido (LFI) et auquel participent un certain nombre de ses collègues parmi lesquels Elsa Faucillon (PCF), Jérémie Iordanoff (EELV) et Marietta Karamanli (PS), a tenu sa première conférence de presse le 16 mai. Il est une enceinte toute désignée pour jeter les ferments de ce qui pourrait devenir un jour un programme constitutionnel commun.
La présente note a aussi pour objet d’apporter de l’eau à ce moulin.
Ce futur programme se trouve quelque part, entre la capacité d’organisation, de structuration du débat public et d’impulsion des partis, leur histoire critique – plurielle, du reste – vis-à-vis de la Ve République, et la capacité d’invention de la société civile.
Dans ce dernier champ, les propositions sont importantes et de qualité. Il y a le collectif Sénat Citoyen dont j’ai parlé plus haut. Il y a le Collectif pour une Convention Citoyenne sur la Démocratie, qui vient de lancer une pétition sur la plateforme du Conseil économique, social et environnemental, à signer ici, visant à la réunion d’une convention citoyenne tirée au sort chargée de formuler une proposition de réforme de la Constitution et des institutions.
Il y en a encore bien d’autres, qui souvent avancent de conserve.
Comme on dit : « y a plus qu’à ».
* Je dois à Dominique Chapuy, de Sénat Citoyen, la mobilisation de la notion de consentement, qui me semble en effet devoir tenir une place centrale dans les questions qui nous occupent.