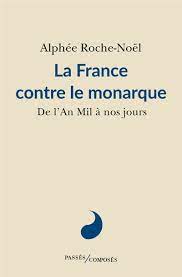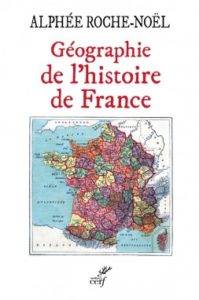Au moment où je publiais mon dernier billet, les gauches « irréconciliables » contrecarraient, contre toute attente, la stratégie macroniste de la « grenade dans les jambes ». En l’espace de quelques jours, elles faisaient l’union réclamée par leurs sympathisants dans leur diversité. Chacun alors jouait collectif. Mélenchon, le jeudi, évitait même le piège d’un débat avec Attal et Bardella. Le lendemain vendredi, devançant les deux autres principales forces politiques en lice pour les législatives, le Nouveau Front populaire rendait public un programme globalement roboratif. Le réflexe de défense démocratique que j’appelais de mes vœux, avec d’autres, dès le début de mai, prenait l’allure d’un mouvement offensif, de transformation sociale. L’espoir était permis.
Le soir même, cependant, un premier coin était enfoncé dans l’union… par la gauche elle-même. Au prétexte, dirait-on dans le courant du week-end, que « les investitures à vie n’existent pas », Garrido, Corbière, Simmonet, Davi, Mathieu devenaient persona non grata d’un mouvement dont ils avaient été parmi les piliers. Pas d’investiture à vie. Voici un argument qui devrait me convaincre, moi qui ne cesse de pointer le problème de la centralité de l’élection, au détriment de la procédure plus authentiquement démocratique du tirage au sort. Mais d’un chef de parti qui roule sa bosse en politique depuis quatre décennies, sans avoir l’air de douter qu’il doive encore y tenir une position éminente, je m’en étonne plutôt. Et je déplore plus encore, dans un moment où la cohésion apparaît indispensable, le mauvais signal qu’a constitué l’éviction de personnalités connues pour leurs efforts en faveur du rassemblement. Au-delà de ces cas particuliers, de leur résonance dans le contexte général que l’on sait, l’affaire pose une question qu’il faudra bien accepter de regarder en face si nous entendons nous placer collectivement à la hauteur des ambitions que nous proclamons. Est-il acceptable qu’une organisation politique, a fortiori quand celle-ci se réclame de la 6e République, n’ait pas de contrepouvoir organisé en son sein ? À titre personnel, j’en doute ; il revient aux militants de la FI qui croient dans la nécessité de leurs combats de se le demander. Si, pour reprendre les termes de Samuel Hayat (Libération du 18 juin), le « camp » auquel cette formation politique appartient veut être « porteur d’une perspective de démocratie réelle », alors, ce ne peut être un sujet secondaire.
Ceci étant posé, le péril de mort auquel la société fait face, à court comme à moyen terme, nous impose, sans nullement délaisser ni ce problème, ni les autres qui se posent à la gauche réunie, de continuer de battre la générale. Comme je le pressentais dans un papier publié voici deux ans sur QG, le macronisme est mort. Le barrage qu’il croyait encore pouvoir incarner s’est définitivement effondré dans la dissolution, dans les déclarations empuanties de Macron aux citoyen•nes de l’île de Sein, en ce funeste 18 juin, dénonçant un programme du Nouveau Front populaire « immigrationniste », budgétairement « quatre fois pire » que celui du RN, et dans lequel il aurait été imaginé de pouvoir « changer de sexe en mairie ». Jamais probablement pareil condensé d’infox et de manipulations scabreuses n’aura tenu dans si peu de paroles d’un président de la République en exercice… mais, il est vrai, en campagne. Même d’ex-députés Renaissance conviennent désormais que leur ancien champion est devenu pour l’extrême centre un danger ambulant. « On ne peut pas l’enfermer jusqu’au 7 juillet ? » demande ainsi l’un d’eux (Le Parisien du 20 juin). Non content d’avoir « craqué, pour y voir clair, une allumette dans une pièce pleine de gaz » – selon le mot de feu Devedjian, remis au goût –, le « locataire de l’Élysée » jette encore de l’huile sur un brasier qu’il est, moins que jamais, en capacité d’éteindre.
Tout, en ce moment, témoigne de cette ambiance où les idées et les mots sont sens dessus dessous. J’ai cité dans mon dernier papier l’ineffable cardinal de Retz, le mémorialiste sagace de la Fronde ; je le pourrais encore en parlant avec lui de « l’extravagance de ces sortes de temps, où tous les sots deviennent fous, et où il n’est pas permis aux plus sensés de parler et d’agir toujours en sages. » Ces termes ne semblent-ils pas avoir été forgés pour un autre temps extravagant : le nôtre ? Ainsi de l’ancien « chasseur de nazi » Serge Klarsfeld, devenu, après des déclarations délirantes, odieuses au travail de mémoire, la caution d’un parti par essence xénophobe – je dirais même plutôt, pour reprendre une idée que j’ai développée ici : hétérogénophobe. Sur cette question sensible, inflammable, partout exploitée et manipulée, Vincent Lemire et Arié Alimi tentent (Le Monde du 21 juin) de jeter un rais de lumière. Distinguant dans une tribune « l’antisémitisme contextuel, populiste et électoraliste », qu’ils ont pu voir « instrumentalisé par certains membres de la FI » de « l’antisémitisme fondateur, historique, ontologique du RN », ils pointent la « pédagogie » qui inspire selon eux le Nouveau Front populaire, permettant « de faire progresser l’ensemble de ses partenaires » et d’aboutir à « des engagements concrets ». Pas d’absolution des errements passés, donc, mais un processus de construction politique à entreprendre. Personnellement, je ne crois pas qu’il y ait d’autre voie que celle-ci.
À ce sujet, sans trop m’étendre, je voudrais formuler l’hypothèse que, même « de gauche », le populisme, en quelque point de la pensée, en quelque endroit du débat, finit toujours par se réaliser contre la société, c’est-à-dire par réfuter la complexité de celle-ci au détriment de ses composantes demeurées dans l’angle mort des stratégies de conflictualisation. Ceci, me semble-t-il, mériterait d’être considéré dans la perspective de la reconstruction durable, à partir du Nouveau Front populaire, d’une gauche qui assume d’être non pas tant le parti d’un peuple à géométrie variable, que celui de la société, conçue dans sa capacité à inventer, dans le cadre d’institutions politiques où elle conquerrait enfin son droit de cité, les conditions d’une vie commune juste et digne pour toutes et tous. Je renvoie ici à ces mots lus il y a peu de jours dans une tribune de Philippe Corcuff et plusieurs universitaires (Le Monde du 6 juin.), qui fournissent matière à réflexion : « On ne peut pas établir de frontière intangible entre une catégorie homogène de « dominants » et une catégorie homogène de « dominés ». » Quiconque s’est rendu le 23 mai à la réunion du collectif Golem, ou, le 20 juin, au rassemblement de la Bastille en soutien à la très jeune fille victime d’un viol antisémite, et contre toutes les violences racistes, antisémites et sexistes, a pu éprouver très concrètement leur urgente nécessité.
Pour l’heure, il s’agit de tenir ensemble, de contenir ensemble, s’il est possible, la poussée du RN, ou de résister ensemble à la réalisation de son dessein idéologique. Quand on est un•e démocrate doté•e d’un minimum de discernement, pas une heure peut-être ne passe, en ces semaines vertigineuses, où l’on n’envisage les conséquences possibles, et affligeantes, d’une victoire de l’extrême droite le 7 juillet. On songe bien sûr aux plus immédiates : aux énergies mauvaises qui se libèreraient d’un coup chez ceux qui rongent depuis longtemps leur frein et se croiraient désormais tout permis, à la répression féroce des inévitables protestations, aux suites politiques d’une possible situation de chaos (l’article 16 ?). On songe tout autant aux nombreuses mesures qu’un gouvernement dirigé par Bardella (ou Ciotti ?) adopterait dans le cadre de son pouvoir réglementaire, ou parviendrait à faire voter à l’Assemblée. Mais on se figure également que l’histoire pourrait ne pas s’écrire aussi simplement : qu’une configuration parlementaire peu lisible ne serait pas moins favorable à une extrême droite alors en situation de se prétendre empêchée de mettre en œuvre son programme, et d’exiger par conséquent un mandat clair pour la présidentielle, dans la plus pure tradition bonapartiste. De ce schéma, Bardella n’a-t-il pas esquissé l’épure, en déclarant qu’il ne serait pas Premier ministre, s’il ne disposait pas d’une majorité absolue ? On peut y déceler une manière de mobiliser « son électorat », tout autant qu’une stratégie à trois ans. Probablement nous ne sommes pas au bout de nos surprises, ni de nos peines.
En attendant ces moments de vérité, Le Pen peut tirer profit d’une époque où la parole publique est devenue largement asémantique pour continuer de fiche les principes cul par-dessus tête. « L’abomination pour le pays, dit-elle, c’est la Nupes 2, qui est pire que la Nupes 1. C’est l’islamo-gauchisme qui prône de manière presque assumée la disparition de l’ensemble de nos libertés. La première d’entre elles étant la liberté d’être français et d’en tirer quelques bénéfices : la liberté de posséder, la liberté de manifester, la liberté d’expression. Ils souhaitent le désarmement physique et moral de la police, sont pour la mise à bas de notre structuration constitutionnelle et républicaine. » (Le Figaro du 17 juin.) Macron, il est vrai, ne dit plus vraiment autre chose, ou alors, dans l’épaisseur du trait. N’a-t-il pas lui-même œuvré à affaiblir les libertés qu’il avait mandat de garantir ?* Sur ce chapitre non plus nous n’avons encore rien vu.
Au point où nous sommes, il n’est pas inutile de penser sans attendre les formes que nous pourrions donner, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années, à notre opposition à l’extrême droite de gouvernement. Ceci vaut bien sûr au premier chef pour les nombreux fonctionnaires qui pourraient avoir à exécuter des ordres en contravention à nos principes républicains. Sur ce point, le fondateur et co-porte-parole du collectif Nos services publics nous aiguille par avance, en faisant valoir à ses collègues, que : « Des guichets aux préfets nous faisons des choix, nous exerçons notre métier d’une certaine manière, et ces choix ont une implication politique. » (Le Club de Mediapart, 10 juin.) Mais le problème dans sa généralité se pose à l’ensemble de la société civile militante, plus ou moins organisée. Comment réagirait-elle, comment réagirions-nous, à un accession du RN au pouvoir ? Nul doute que tout ce qui pourrait être commis en infraction à la loi, sous le coup de la colère, par exemple, à compter du 7 juillet au soir, se retournerait immanquablement contre nous. Manifester – notre désarroi, notre désapprobation, notre résolution – qui pourrait nous en prévenir ? Mais alors, manifester avec la dignité qui sied à la situation gravissime où nous nous trouverions, sans concéder, pour des motifs futiles, le moindre prétexte susceptible de compromettre des actions plus utiles, plus porteuses de fruit dans l’avenir. Serait-ce faire preuve d’esprit de défaite, que d’évoquer déjà de telles perspectives ? Plutôt d’esprit de suite. D’ici là, c’est dans les urnes que se joue la lutte pour nos droits.
*Ainsi, notamment, concernant l’exercice de la liberté de manifestation – ou, à la marge, d’expression –, auquel des restrictions sournoises ont été apportées, dans la pratique, ces dernières années. Sans même parler des nasses, des nuages de gaz lacrymogène déversés dans les cortèges, etc., je voudrais en rapporter quelques indices, d’une nature plus insidieuse, tirés d’expériences personnelles. L’an passé, par exemple, l’accès à une manifestation m’est refusé parce que je porte une pancarte. « Ce sont les ordres », me dit-on. « Vos ordres sont illégaux », répondé-je. Le chef s’en vient, j’obtiens gain de cause. Le 1er mai dernier, c’est la sortie que l’on me refuse, si je ne replie pas ma banderole. « Ce sont les ordres. » « Vos ordres sont contraires à la Déclaration des droits de l’Homme. » Cette fois-ci, je m’exécute. Comment faire autrement, devant un cordon de CRS ? Tout récemment, au sortir de la manifestation du 15 juin, cet autre épisode, significatif d’une sale ambiance, dans une sale période. Lorsque je me dirige vers les portillons du métro Nation, une autre banderole entre les mains, en compagnie de mon amie et de ses parents, je suis prié par un membre d’une CRS de me ranger sur le côté pour un contrôle d’identité. « Vous avez quelque chose de dangereux sur vous ? » me questionne-t-on. Je réponds : « Non, je suis pacifiste », ce qui est bête, l’affirmation même sincère d’une posture morale pouvant être prise pour une provocation. Les fonctionnaires sont deux ou trois autour de moi, une huitaine à quelques mètres. Palpation de sécurité, ouverture de mon sac à dos. Tous mes effets personnels sont examinés, poche après poche. Parce qu’il s’y trouve quelques doses de sérum physiologique, on me demande si je suis « street medic ». Je commets l’imprudence de dire : « J’ai des allergies aux pollens », ce qui, par ailleurs, est vrai ; on me rétorque : « Il n’y a pas de pollen, quand il pleut », ce qui est idiot. Il faut ici relire Kafka, se rappeler qu’on fait toujours parler les naïfs malgré eux, quand le droit les autorise à garder le silence, et quand le bon sens les y engage. Téméraire, peut-être, mon amie demande pourquoi c’est moi qui suis contrôlé. Réponse d’une policière zélée : « Très bien, Madame, mettez-vous sur le côté, nous allons vous contrôler également », et c’est parti pour un second contrôle, celui-ci, nettement injustifié. Ses parents s’approchent, sa mère tente de parlementer. Alors, d’un geste de la main, un policier : « Reculez, vous êtes dans notre périmètre de sécurité. » Son père marmonne quelque chose, que je n’entends pas. Un autre, si je me rappelle, grand, costaud, à l’affût de la faute : « Répétez, Monsieur, nous n’avons pas compris. » Ils sont huit ou dix, en uniforme, armés, dépositaires, comme disait Darmanin détournant Weber, du « monopole de la violence légitime ». Nous sommes quatre, de toute évidence inoffensifs. Le ton monte. Pourquoi ? Pour rien. Et à moi, encore : « Vous avez déjà eu affaire à la justice ? Vous avez déjà été en garde à vue ? » À ces questions qui n’ont pas lieu d’être, j’objecte : « Je ne comprends pas, Monsieur, pourquoi vous me demandez cela. » De fait, que j’aie déjà ou non eu affaire à la justice dans ma vie n’a rien à voir à l’affaire. Mon interlocuteur apprécie modérément ma repartie, semble croire que je suis gêné par ses questions en tant que telles, alors que c’est leur principe que je conteste, l’idée instillée dans l’esprit de la personne contrôlée qu’elle pourrait ne pas se sentir très à l’aise d’avoir déjà « traversé en dehors des clous ». J’aurais mieux fait de me taire, la question qui devient discussion risquerait de m’amener sur une pente glissante. (À propos justement du comportement à adopter en cas de contrôle d’identité, je crois utile de renvoyer ici à l’excellente documentation réalisée sur ce sujet par la LDH.) On screen enfin ma CNI afin de vérifier si je ne suis pas inscrit au fichier des personnes recherchées ; l’affaire s’arrête là, je n’ai, selon le vocabulaire consacré, « rien à me reprocher ». Au sortir de cette séquence dérangeante, je songe aux populations racisées pour lesquelles cette procédure inlassablement répétée prend le tour d’une humiliation systématique. Et je m’interroge sur le cas précis auquel je viens d’être confronté. Pourquoi, au fait, ce contrôle, alors que je chemine, de toute évidence, en famille, avec entre les mains une banderole encombrante au point qu’il paraît déraisonnable d’imaginer que je puisse participer à quelque violence que ce soit ? Je n’ai pas la réponse. Alors, je suppose, j’extrapole : pour impressionner, donner une petite leçon, au passage. Une leçon de quoi ? Pas une leçon de morale républicaine, en tout cas : sur la banderole, en effet, il était écrit : « France, souviens-toi de ta devise ».
Ce billet a été publié simultanément dans l’espace « blogs » du Club de Mediapart.