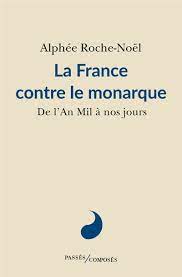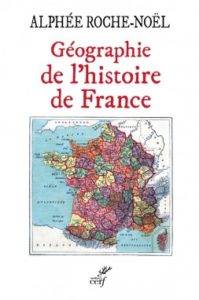L’histoire est œuvre d’interprétation – et, bien souvent, de subversion. Chacun s’empare des concepts et des faits passés comme des trésors d’une mine, pour se les approprier. Il n’est pas une idée qui soit vierge, qui soit pure. Dès l’instant où elle éclot elle ne s’appartient plus : elle est livrée à la communauté des humains pour y être assimilée et transformée, recrachée sous une forme nouvelle. C’est le mouvement naturel des choses. Mais il est des interprétations plus ou moins cyniques, plus ou moins intéressées.
Admettons pour schématiser qu’on peut ranger celles-ci dans trois catégories.
La première est d’ordre scientifique, philologique. Elle suppose une démarche consciente, animée par un souci de vérité, étayée par un effort de contextualisation.
La seconde est doxique : elle relève de l’opinion, du flot incoercible des pratiques culturelles. Elle n’est pas malintentionnée.
La troisième est rhétorique. Elle vise à produire un effet dans l’ordre doxique au mépris de l’exigence de vérité.
Encore cette troisième catégorie n’est-elle pas néfaste en toute hypothèse. S’y logent les mille petites libertés prises avec le réel que suppose tout discours et plus spécialement tout discours politique. Mais en font également partie les entreprises méthodiques, résolues, à grande échelle, de subversion des valeurs, comme celle à laquelle se livre, depuis disons dix à quinze ans, la grande famille des extrêmes droites et droites extrêmes en voie d’unification.
De cette entreprise et de son effet sur le public, la réaction de la classe politique au meurtre du jeune sympathisant ethnonationaliste Quentin Deranque fut l’éclatant témoignage – et la minute de silence organisée à l’Assemblée en hommage au défunt, une sorte d’épiphanie.
Comme l’assassinat de Charlie Kirk, ce drame autrement banal, mais non moins tragique, de la violence politique, servait à blanchir l’ultradroite de sa brutalité congénitale et à camper symétriquement la figure d’une extrême gauche par nature violente, criminelle, terroriste. Partout l’on entendait d’aimables et frêles camarades du jeune homme, tous membres des mêmes mouvances, nous expliquer leur peur de défendre pacifiquement leurs idées philanthropiques face à l’agressivité du camp-d’en-face.
Soudainement obnubilés par la « Jeune Garde », mystifiés par le récit du péril « antifa » les esprits oubliaient – pour autant qu’ils en eussent eu connaissance… – les groupuscules néofascistes implantés dans tant et tant de villes de France et qui s’y emploient à terroriser les formations progressistes à coup de barre de fer et de slogans racistes. Extrême gauche et extrême droite n’étaient plus seulement renvoyées dos à dos, comme bornant de part d’autre l’introuvable « arc républicain » ; elles étaient mises cul par-dessus tête. Le gauchisme menaçait la société, le « patriotisme » allait l’en préserver. L’ambiance, toutes proportions gardées, n’était pas sans rappeler l’Allemagne du début 1933, ou l’Amérique MAGA.
Ce travestissement du réel en suit bien d’autres et il n’est pas interdit de supposer qu’à ce niveau d’incandescence il ferme une boucle et ouvre un cycle.
Il ferme premièrement la boucle des signifiants qui permettent ensemble de contrôler et de mobiliser l’opinion publique, d’affirmer cette fameuse « hégémonie culturelle » impudemment soustraite à Gramsci et où l’on trouve, pêle-mêle, le « racisme antiblanc », l’« écoterrorisme », le « wokisme » ou encore l’« islamogauchisme ». Que l’on y prête un peu attention et l’on se rendra compte que ces items fantasmatiques ne doivent rien au hasard, puisqu’ils servent chacun à cibler spécifiquement une dimension particulière des minorités et/ou du mouvement progressiste.
Il ouvre, c’est à craindre, un cycle d’événements redoutables, puisque désormais tous les mobiles sont en place qui semblent justifier, aux yeux d’un large public, une répression bien plus massive et systématique de ces mêmes parties de la population – auxquelles, sous un aspect ou sous un autre, nous sommes nombreux à appartenir.