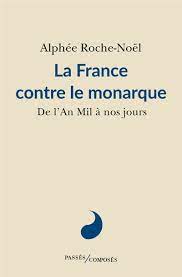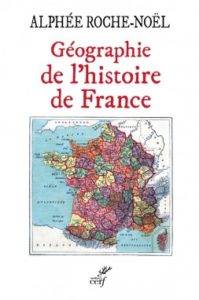Après ce 20 janvier 2025 et les images sidérantes qui nous sont parvenues de Washington, on peut être tenté, selon la formule consacrée, de « garder le silence ».
À quoi bon s’exprimer, en effet ? Les mots aujourd’hui se perdent tous dans un océan de paroles dont on ne sait même plus si elles sont le fait d’humains ou de robots.
Mais, en même temps : comment ne pas s’exprimer ? Ne faut-il pas, pour le bien de sa propre conscience, la délester des pensées qui la hantent ?
C’est l’option que je prends en me livrant à cette manière de catharsis.
Ce 20 janvier, donc, l’une des plus anciennes républiques au monde – qui se trouve aussi en être l’État le plus puissant – vient de se transformer, sous nos yeux et dans les formes de la démocratie électorale, en un régime autoritaire d’un type nouveau, conçu par et pour la société spectaculaire : une sorte de fascisme de barnum.
Sans doute, dès l’origine, les colonies britanniques d’Amérique du Nord furent un système brutal, inégalitaire, prédateur : pour les autochtones spoliés et exterminés et pour les Noirs réduits à l’esclavage. À maints égards, jusqu’à nos jours, les États-Unis d’Amérique sont restés le pays de la violence – celle du IIe amendement – et de la démesure capitaliste.
Mais enfin, cette fédération d’États n’en avait pas moins été pensée comme la restauration d’un régime de liberté qui, du point de vue des colons britanniques du Massachusetts et de la Virginie, donnait, dans l’Angleterre de Walpole et de North, tous les signes de la décadence et de la corruption. Au contraire, l’Union reposerait sur le droit et sur ce principe des « checks and balances » qui était leur interprétation de l’« antique » constitution anglaise. Avec leurs incohérences et leurs parts d’ombre, les Jefferson, les Madison et les Adams, les Franklin et les Washington avaient au moins ceci pour eux de croire dans le respect de la légalité et de redouter la tyrannie de la majorité. D’une certaine manière, malgré les crimes et les excès qui sont le lot de toutes les grandes puissances, les États-Unis sont, jusqu’à la réélection de Donald Trump, demeurés fidèles à ces principes. En tout cas dans leur ordre interne.
Or tout ceci vient d’être biffé, d’un trait de plume, sur un bureau présidentiel transbahuté pour les besoins de la cause au milieu de la Capital One Arena.
La corruption que les « Founding Fathers » avaient cru discerner dans les gouvernements anglais du XVIIIe siècle – l’esprit de servilité, les féodalités menaçantes, le pouvoir sans frein – semble cette fois-ci s’être transportée de l’autre côté de l’Atlantique, au plus haut sommet de l’État, ensemble avec les magnats de la tech, une équipe effrayante de technocrates et de professionnels du national-populisme et, pour donner le change aux petites habitudes de l’ère démocratique, ce qu’il reste du « Grand Old Party » d’Abraham Lincoln et des institutions de la Convention de Philadelphie.
Biden, lucide au moins dans ses derniers moments à la tête de la République américaine, a dénoncé une « oligarchie […] de l’extrême richesse, pouvoir et influence qui menace littéralement notre entière démocratie, nos droits et libertés ». Ainsi, la veille de l’investiture de son successeur, il faisait vivre encore un peu la longue histoire constitutionnelle de ce pays vieilli avant l’âge. Quant à nous toutes et tous, en quelques heures de temps, nous avons été les témoins de ce qu’il faut bien appeler une révolution antilibérale, antidémocratique, dont les symboles furent notamment :
– le serment d’un président parjure – que le XIVe amendement aurait dû empêcher de seulement candidater à sa réélection… – de « préserver, protéger et défendre la Constitution » ;
– les déclarations à l’emporte-pièce, discriminatoires, de ce même personnage ;
– la comédie de signature des décrets de « mass deportation », de destruction des lois environnementales et du droit international devant la foule enivrée de ses supporters (ou, en anglais, de ses fanatics) ;
– et, pour couronner le tout, le salut nazi, face à cette même foule, de l’homme le plus riche du monde, qui se trouve aussi et pour cette raison même être l’un des plus dangereux, allié de circonstance du président réélu.
Je n’imagine pas que quiconque possède encore une once d’esprit démocratique et critique – cela va souvent de pair – puisse sortir de cette séquence autrement que dans un état de profond abattement.
Surtout, je ne vois pas quel espoir pourrait aujourd’hui nous faire relever la tête.
Dans son discours d’investiture, Trump a affirmé : « nous sommes au seuil des quatre plus grandes années de l’histoire américaine. »
Qui cependant peut croire que, de l’Amérique à l’Europe, nous nous trouvions encore dans cette temporalité démocratique où nous avions à force pris nos aises et qui nous permettait jusque récemment de dire : aux États-Unis, dans quatre ans, en France, dans cinq ans, etc. ? Trump sans doute moins qu’aucun autre.
En 1848, les républicains français espéraient dans le deuxième dimanche de mai 1852, date normalement fixée pour l’élection du successeur de Louis-Napoléon Bonaparte, arrivé au pouvoir par la voie des urnes. Entre-temps, il y eut un autre « 18 Brumaire » et la République disparut avec les espoirs de ses soutiens, réduits pour 20 années au silence le plus complet.
Certainement, au point où nous sommes du pourrissement des régimes « représentatifs » – qui ont leurs défauts comme ils avaient leurs qualités –, nous nous trouvons moins « au seuil des quatre plus grandes années de l’histoire américaine » qu’au commencement d’une période de profonde noirceur, hantée par des monstres bien trop gros pour nous.