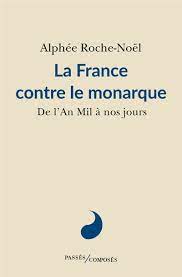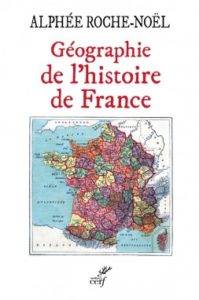Un exemple de mystification historique, Bonaparte visitant les pestiférés de Jaffa – Antoine-Jean Gros, 1804.
Lorsque j’ai commencé ce billet, le ciel n’avait pas encore craqué au Proche-Orient. Depuis lors, les manifestations en soutien aux expulsés de Cheikh Jarrah ont rappelé aux Palestiniens ce qu’il en coûte de défendre leurs droits face au gouvernement nationaliste, belliciste de Netanyahou. Comme attendu, le Hamas a tenté de noyer le Dôme de fer sous une pluie de roquettes, tirées à vue ; comme attendu, Tsahal a répondu par un déluge de feu sur la bande de Gaza. Les moyens de guerre déployés, le déséquilibre du nombre de victimes désignent, sans qu’il soit besoin d’épiloguer, la partie à laquelle il revient, moralement, politiquement, de tendre la main, en commençant par garantir le droit de l’autre à vivre sur ses terres ancestrales, dans la dignité. Las !, personne, parmi les puissances occidentales, ne veut agir – il faudrait pour cela commencer par reconnaître l’injustice – et le sémillant Biden semble avoir perdu de sa superbe dans l’opération, se contentant de paroles lénifiantes sur Jérusalem, « ville d’importance pour les croyants du monde entier » devant être un « lieu de paix », et refusant de voir une « réaction excessive » dans la riposte massive et cruelle de l’État hébreu. Pendant ce temps, Benny Gantz, général-ministre de la défense d’Israël peut librement adresser aux Palestiniens ce message de chantage et de terreur : « Gaza brûlera » et « il n’y aura pas d’Aïd aujourd’hui», rendant toute la population gazaouie responsable des attaques menées par le Hamas. (Comment, en l’état, pourrait-elle ne pas s’en sentir solidaire ?)
À Paris, la voix inaudible de la diplomatie française ne sera pas suppléée, en tout cas pas légalement, par celle des manifestants pour les droits des Palestiniens, comme êtres humains et comme peuple. Darmanin, donc Macron, excellents manieurs de principes à géométrie variable, ont interdit le rassemblement déclaré en préfecture, prétexte pris des échauffourées survenues en 2014 dans des circonstances similaires. Je ferai grâce à mes lecteurs de m’engager dans la critique serrée de cet outrage à la démocratie et de l’argumentaire aberrant qui le justifie – au pays de l’absurde, Ubu est roi – pour en venir enfin au sujet principal de cette chronique.
On sait que le 5 mai dernier, Macron a tenu à commémorer le bicentenaire de la mort de Napoléon. Ce jour-là, tout en exaltant « l’action et les leçons du guerrier, du stratège, du législateur autant que du bâtisseur », notre Premier consul à nous n’a pas manqué de rappeler qu’en 1802, celui qui était encore connu sous le nom de Bonaparte avait rétabli l’esclavage, aboli huit ans plus tôt par la Convention nationale. (Au passage, il omettait de mentionner que la Convention n’avait fait que reconnaître les conséquences de la Révolution de Saint-Domingue, accomplie par les Noirs eux-mêmes contre les planteurs, mais ceci dépasse les limites de mon sujet.) Ce débat historiographique – normal et sain – autour de l’« héritage napoléonien » éclipsait cependant un autre sujet, encore plus actuel : la persistance de la tradition césariste, bonapartiste, dans notre propre régime constitutionnel. Ainsi, on évoquait l’esclavage, rétabli par Bonaparte, puis définitivement aboli par la IIe République, mais on semblait oublier que le régime antirépublicain, antidémocratique, instauré par le « petit caporal », avait, lui, survécu aux outrages du temps, tel un pernicieux virus emprisonné dans les glaces, pour finalement reprendre corps dans la Ve République. La dictature de Bonaparte était née d’un coup d’État militaire ; le régime gaullien naîtrait d’un coup de force, sous la menace d’un putsch.
Contre ce régime insensé, qui confère à un monarque élu des pouvoirs exorbitants, potentiellement incontrôlables, tout devrait nous mettre en garde. Notre propre histoire républicaine ne s’est-elle pas construite contre la captation de la chose publique par un personnage unique ? Et ceci de 1789 à l’affermissement de la IIIe République, en passant par la Commune de Paris. « Rien n’est commun dans ce gouvernement où tout est à un », nous alertait La Boétie, il y a cinq cents ans. Pourtant, après tant d’âpres luttes, nous perpétuons le privilège asservissant de glisser un bulletin dans l’urne pour désigner notre césar. Pour la dixième fois depuis 1965, l’élection présidentielle agit dans notre vie politique comme un gigantesque trou noir, aspirant tout objet qui passe à sa portée. Voyez les campagnes pour les élections régionales, où Macron, où Le Pen poussent leurs pions, se disputent le coup d’après, sans égard pour le mandat en jeu – dans les Hauts-de-France, en PACA, en Occitanie. Voyez les médias, écrasés par l’ombre de ces absurdes duellistes qui partagent le même mot d’ordre : « moi ou le chaos ». Un jour, une amie a parlé de la présidentielle comme d’une élection monstrueuse, ne pouvant accoucher que d’un monstre. Sans placer en l’occurrence les deux compétiteurs dans une même dimension horrifique, je souscris totalement à cette parole de sagesse.
Ce monstre institutionnel, la gauche l’a fait sien en prenant l’Élysée, le 10 mai 1981. Mitterrand, qui avait fourbi ses armes contre le régime de 58, a fini par s’en faire le prince par excellence. Quarante ans plus tard, presque jour pour jour, Bernard Cazeneuve, ex-premier ministre de François Hollande, peut tranquillement nous expliquer que « la gauche de demain doit (…) revendiquer la tradition gaulliste »*. Les faits lui donnent raison : l’ensemble des partis qui se réclament de cette famille politique sont englués dans l’épouvantable mélasse laissée dans le sillage du général. Et la seule formation représentée au Parlement qui se propose de dépasser la Ve République doit, pour ce faire, passer sous les fourches caudines de la présidentielle. Un comble.
À tout prendre, il n’est pas surprenant que les institutions ne sécrètent pas d’elles-mêmes la solution au problème qu’elles ont créé. Le bonapartisme est au cœur de l’État : l’empereur est mort il y a deux cents ans, mais chaque élection présidentielle ressuscite le mythe de l’homme providentiel. Pour le pire semble-t-il, puisque désormais même Le Pen peut revendiquer l’héritage de Napoléon et de De Gaulle, avec de bonnes chances de l’emporter. Quoi de plus normal, quand on a l’autoritarisme dans les veines ? En fin de compte, l’argument de « la dictature pour nous sauver de la dictature » pourrait bien passer par pertes et profits en 2022.
Avant d’aller déposer sa gerbe aux Invalides, Macron a affirmé n’avoir « nulle volonté de dire si Napoléon a concrétisé ou bien au contraire a dévoyé les valeurs révolutionnaires ». Lever l’ambiguïté était pourtant l’essentiel, car si la souveraineté populaire a formé le socle de ces « valeurs révolutionnaires », désormais largement sous le boisseau, alors, nul doute que Napoléon les a dévoyées, les a subverties à son profit, et nul doute non plus que la Ve République a continué son œuvre, avec, certes, un peu plus de tact.
Alors que la société, depuis les Gilets jaunes et les autres grands mouvements des deux dernières années, depuis la crise sanitaire, montre tant de signes de sa volonté et de sa capacité à s’organiser elle-même, il est paradoxal et navrant que notre horizon politique se résume à une resucée de plébiscite bonapartiste, à un vulgaire combat de coqs, au détriment des aspirations populaires.
À moins que l’histoire n’ait pas dit son dernier mot ?
*L’Express du 6 mai 2021.