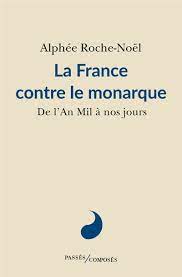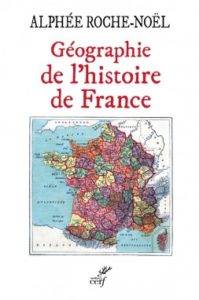Le salut fasciste d’Elon Musk le 20 janvier dernier dans la Capital One Arena a produit l’effet attendu : stupéfier les commentateurs, « dog-whistler » les nostalgiques d’Hitler et Mussolini et, surtout, normaliser l’inacceptable. À preuve : l’inacceptable s’est produit et semble déjà oublié : une vague parmi tant d’autres dans la tempête qui déferle sur le monde.
Chez quiconque entend s’opposer à cette normalisation, la question cependant reste pendante de la nature du régime advenu au pays de George Washington, en ce jour de décrets et de symboles. Se donner les moyens de saisir l’histoire, afin de n’en pas demeurer le sujet inerte, le spectateur passif, suppose de se rendre capable, sinon d’en nommer exactement les phénomènes au moment où ils se produisent, du moins de les décrire, de les qualifier, de s’attacher à les comprendre – en l’occurrence, pour mieux les combattre.
Dans le syncrétisme extrême-droitier qu’agrège un trumpisme paradoxalement très pauvre en idéologie, la composante fasciste est, depuis le geste de Musk, apparemment la plus évidente. Et cependant, en songeant seulement à comparer l’Amérique MAGA à l’Italie du
« Duce », l’on se sent immédiatement appelé à la prudence, prévenu contre le réemploi, contre le recyclage abusif des concepts historiques ; l’on perçoit les distances immenses qui séparent les deux phénomènes, celui des années 1920 et celui des années 2020, comme s’ils appartenaient à deux dimensions différentes.
De fait : le fascisme est né en Italie, quelque part au tournant des années 1920, il y a vécu, il y est mort. Il eut en Allemagne un proche parent, incomparablement barbare, destructeur et raciste, et des cousins issus de germain en Espagne et en France, plus nettement réactionnaires. Il se référait aux faisceaux des licteurs – d’où son nom – et se croyait l’héritier de cette Rome antique avec laquelle, par la force des choses, il ne pouvait rien partager d’autre que l’humaine condition et la folie des grandeurs.
Nourri des courants aussi divers que prolixes et agissants de l’extrême droite européenne – français, notablement –, ce fascisme princeps abhorrait le marxisme, réfutait – ou prétendait réfuter – le capitalisme, et ambitionnait d’ouvrir une troisième voie, celle d’une société corporatiste, violemment hiérarchique et passionnément nationaliste, sous la houlette d’un État total. En le définissant, de retour de l’Allemagne en cours de nazification, comme « la réponse de la bourgeoisie à la carence ouvrière, une tentative pour sortir du chaos, pour réaliser, sans trop compromettre les privilèges de la bourgeoisie, un nouvel aménagement de l’économie, un ersatz de socialisme », Daniel Guérin a assez exactement défini un « système » dans la description duquel nous ne croyons pas nécessaire d’entrer plus en profondeur.
Employé à tire-larigot, souvent dévoyé, le mot fasciste, pourtant terrible et infâmant, en est venu, à force d’être jeté comme une banale insulte, à ne plus désigner, pour les peuples oublieux d’Europe, que l’ombre du réel, une figure lointaine, une vague réminiscence. À mesure que l’histoire s’éloignait, il put même prendre un tour comique, l’écho drolatique des jurons du capitaine Haddock. Pourtant, quand Bernard Campan nous faisait rire en brandissant sa « pétition pour la libération d’Abel Chemoul, emprisonné dans les geôles fascistes », l’histoire, cette marâtre, repointait déjà le bout de son nez. Engagés en politiques, certains descendants des fascistes de jadis voyaient déjà grossir leur petite affaire familiale. Le FN, fondé à l’initiative d’un mouvement néofasciste et dont la flamme tricolore copiait celle du MSI, montait lentement mais sûrement, ensemble avec tant d’autres qui occupent aujourd’hui le devant de la scène, y compris dans le pays qui vit naître Mussolini et dont la dirigeante œuvre désormais à arrimer l’extrême droite ascendante du Vieux Continent à celle, triomphante, du Nouveau Monde.
Malgré le temps, malgré l’oubli, malgré les transformations et les travestissements du langage, le substantif fascisme et ses dérivés devaient demeurer, au moins en un sens, actuels et pertinents. Non pas pour identifier un phénomène d’aujourd’hui à l’idéologie mussolinienne ou à une quelconque autre idéologie parente élaborée et mise en œuvre entre 1900 et 1945, mais pour désigner tout régime de pouvoir, toute entreprise politique, nés des contradictions de la société capitaliste, visant à l’application d’un programme nationaliste et recourant pour parvenir à ses fins à la propagande mensongère et à la violence.
Sous cet aspect, si le fascisme est mort comme mouvement politique historique, il revit en quelque façon dans le mouvement MAGA et dans le régime trumpien et, de ce fait, à une échelle inimaginable. Contrairement à son prédécesseur, ce fascisme-là, résolument capitaliste et individualiste, projette de détruire l’État et ne croit que dans l’entreprise privée à laquelle il s’efforce de transférer les moyens de l’ancienne puissance régalienne – toutes options fondamentalement incompatibles avec le fascisme princeps. On pourrait à la limite chercher et trouver quelque similarité entre le caractère « futuriste » du fascisme italien et le délire transhumaniste d’un Musk, mais ce ne serait pas là le plus significatif. L’important est plutôt que, toutes choses étant égales par ailleurs, l’objet politique qui bouleverse aujourd’hui et pour les temps à venir les Etats-Unis et l’Europe procède de causes du même ordre, qu’il s’abreuve, pour partie, aux mêmes sources idéologiques et, surtout, qu’il emploie des méthodes comparables – non pas comparables en degré, mais comparables en nature.
Plastique, voire liquide, le fascisme du big deal et de la big tech tient ses caractères et sa forme inédite du milieu et de l’époque où il a pris corps. C’est un technofascisme, un libertarofascisme. Il ne faut craindre ici ni l’oxymore, ni le paradoxe, qui donnent à voir l’essence du phénomène, sa nouveauté radicale, ses contradictions éventuelles. L’on peut d’ailleurs parier à ce sujet que si, comme cela est prévisible, les entreprises d’extrême droite européennes connaissent bientôt les mêmes succès, leur fascisme sera, selon les cas, plus étatiste, plus corporatiste, moins ouvertement capitaliste.
Ces nuances mises à part, l’un des points communs à toutes ces entreprises, et qui contribue à les rapprocher de l’ancienne manière, réside dans leur propension à gouverner par la manipulation des affects, à mobiliser l’amour et la peur, comme cela se voit en ce moment même aux États-Unis, à un niveau inouï d’incandescence. C’est là leur force, c’est là aussi leur faiblesse, nous y viendrons dans un moment, et nous verrons alors pourquoi il était nécessaire d’en passer par cet effort d’interprétation et de qualification.
L’amour fut savamment exploité par Trump au cours de ses quatre années de reconquête du pouvoir, pour exciter sa base. Mâle pesant et sans grâce, bateleur de téléralité, Béhémoth de cirque ambulant, l’homme s’est néanmoins montré capable de maîtriser les foules MAGA en stimulant leurs pulsions enfouies – Freud, sur cette question de la libido des foules, a fait d’intéressantes remarques. Comédien hors de pair, il amena cette passion à son paroxysme en incarnant, à la faveur d’un attentat pour ainsi dire providentiel, la double figure du martyr et du miraculé.
Quant à la peur, quant aux techniques de la peur, elles sont déclenchées massivement, systématiquement et avec une détermination sans faille depuis l’investiture, dans le but d’atteindre quiconque s’est opposé ou pourrait avoir quelque velléité de s’opposer, quiconque a été désigné à la vindicte par la faconde grossière du chef et incarne par là même, pour reprendre un concept éclairant de Giorgio Agamben, l’homo sacer du XXIe siècle : celui ou celle qu’il est licite d’éliminer – en tout cas d’éliminer de l’espace social et mental.
Ainsi cette peur souffle son haleine putride et tempétueuse sur toutes les catégories minoritaires (au sens moral et politique) de la société américaine, qui sont aussi les plus fragiles et les plus menacées dans leurs droits, leur sûreté, leur sécurité. Il faut se représenter par exemple celle que doivent éprouver, au moment où nous écrivons ces lignes, les personnes migrantes ou LGBTQIA+, dont on a parlé dans un précédent billet. Selon cette logique, la peur doit aussi souffler sur les journalistes, universitaires, magistrats, militants, fonctionnaires, etc., qui soit sont contre la ligne, soit ne sont pas assez dans la ligne, soit ont tout simplement été amenés, du fait de leurs fonctions professionnelles, à déplaire au tyran orange, à ses associés ou à ses clients. Il va sans dire que ce schéma est éminemment reproductible, contre les mêmes groupes de population ou contre des groupes proches, dans les États d’Europe où les entreprises politiques nationalpopulistes possèdent aujourd’hui de bonnes chances d’accéder au pouvoir ou d’y renforcer leur position. Les pressions mises en Italie sur la presse et les juges en témoignent.
La peur MAGA s’étend également sur l’ensemble des pays qui, depuis 1945 et jusqu’au 20 janvier dernier à minuit, pouvaient se croire les alliés des États-Unis d’Amérique. Il fallait voir à ce sujet J.D. Vance et Marco Rubio jouer, à Munich, le numéro du good cop/bad cop, l’un tétanisant son auditoire, l’autre affectant de le rassurer, les deux ensemble le plaçant dans une situation d’extrême insécurité morale. La peur déstabilise, elle rend docile, elle incite à l’obéissance ; c’est une constante de la psychologie cognitive et c’est pourquoi elle fut de tout temps l’un des instruments privilégiés du fascisme pour étendre sa domination et exercer sur la société un pouvoir sans partage.
Par quels moyens cette peur est-elle provoquée ? Certainement, la menace de la violence physique plane toujours quelque part, tel un oiseau de proie dans le ciel trumpiste – il faut lire à cet égard ce qu’écrivait Elias Canetti sur l’ordre de fuite. Ainsi le bouleversement soudain de l’architecture de sécurité européenne, le retrait annoncé des États-Unis de la défense de l’Europe, placent les citoyennes et citoyens du Vieux Continent, à commencer par les Ukrainiens et les Baltes, sous la menace directe de l’impérialisme russe.
Mais quand bien même les « Proud Boys », récemment graciés, évoquent d’effroyables souvenirs, l’usage de la peur ne se manifeste pas ici dans l’action de Chemises noires, de Sturmabteilung, ni même dans l’emploi sans retenue des forces de sécurité régulières. Il se dévoile plutôt dans le recours systématique et abusif au droit et aux médias, en les pervertissant, en les faisant sortir de leur lit (multiplication des procédures bâillon et autres menaces de poursuites, transactions abusives, Truth Social, X, Fox News, etc.). Peut-être cette méthode prendra-t-elle plus tard un tour plus direct, plus brutal, lorsque la société américaine sera plus complètement désarmée – n’oublions pas que le Trump version 1 avait demandé en 2020 à son secrétaire d’État à la défense Mark Epser de faire tirer sur les manifestants massés à Washington lors du soulèvement consécutif au meurtre de George Floyd. En attendant, ce fascisme « light », ce fascisme dans les formes de l’État de droit, peut encore donner aux candides l’impression moralement réconfortante de ne pas y être vraiment.
Pour illustrer notre propos par cet exemple significatif, la purge sans précédent – par son ampleur, par sa rapidité – de l’administration fédérale poursuit deux objectifs symbiotiques :
1° un objectif idéologique : restituer l’État dans son rôle de simple « gardien de nuit » du capitalisme ;
2° un objectif managérial : instiller chez les personnels de l’administration une peur de nature à les discipliner. Il s’agit ici pour Trump, selon la définition que Weber a donnée de la discipline, de se donner le maximum de chances de « rencontrer chez une multitude déterminable d’individus une obéissance prompte, automatique et schématique, en vertu d’une disposition acquise ».
Il est possible de se faire une idée de la vigueur de l’attaque en cours, de ses visées psychologiques, en prenant connaissance des termes, rapportés par le Washington Post (propriété du magnat Bezos, en situation de connivence avec le pouvoir, mais qui continue, après plusieurs censures, de produire des articles de fonds) de la lettre qui fut adressée à des personnels pour les informer de leur mise à pied :
« Malheureusement, l’agence estime que vous ne convenez pas pour l’emploi, que vos capacités, connaissances et compétences ne correspondent pas à ses besoins présents et que votre performance n’a pas été suffisamment satisfaisante pour justifier que vous continuiez d’y être employé. » Si l’on en juge par le fait que certains agents ont choisi de manifester contre leur licenciement le visage masqué afin de protéger leurs proches employés eux aussi par l’administration fédérale, alors, l’opération a réussi au moins en partie.
Naturellement, la peur, l’amour, ne sont que des moyens politiques au service d’une fin : la transformation radicale de la société pour le bénéfice exclusif de groupes dominants désignés par l’histoire – capitalistes, classes moyennes blanches, et, au sein de ces groupes, individus de sexe masculin. Or, ces moyens ne fonctionnent que dans la mesure où de larges pans de la population demeurent apathiques. Heureusement pour Trump, le « capitalisme de l’attention », de la Tech qui lui est inféodée – les réseaux socionumériques, l’IA générative – œuvrent efficacement à désensibiliser l’intelligence, à la distraire, à l’obscurcir, et par là même à anéantir les facultés démocratiques. Mais ce modèle économicotechnologique n’est pas le seul ni même le premier agent de l’apathie sociale : si les pires horreurs ont pu être commises sous le fascisme princeps et ses cousins, c’est parce que, dans sa généralité et jusqu’à ce qu’elle eut été gagnée par l’exaspération liée aux conséquences du fascisme et de la guerre à laquelle ce régime de pouvoir devait inévitablement conduire, la population resta indifférente.
L’étonnant, le choquant, face à ce spectacle épouvantable et aux hypothèses qu’il fournit, clef en main, à tout observateur attentif, c’est la masse indénombrable de citoyens soi-disant avisés qui, de ce côté-ci de l’Atlantique, doutent encore de la révolution à l’œuvre aux États-Unis et se refusent à envisager son caractère indéniablement fasciste. Même au cœur de la tempête, dans le craquement des vagues et des mâts, une lancinante petite musique continue de faire à nos âmes européennes, ardemment désireuses de calme, passionnément éprises de certitudes, l’effet lénifiant d’une berceuse. Pour cette raison il est à craindre que la tragédie états-unienne n’aura même pas ce mérite minuscule de nous mettre en garde, nous qui avons l’honneur d’être les prochains sur la liste. Car n’a-t-on pas dit de Trump ce qu’on dit encore de Le Pen ? : « il ne pourra pas faire tout ce qu’il dit », etc.
Au bord d’un gouffre dont on n’aperçoit pas le fond, il paraît impossible de conclure, de se projeter, en pensée, autre part que dans le vide. À ce stade, toutefois, on peut au moins tirer quelques fils, rassembler nos idées pour les mettre au clair. Donc, quels que soient le ou les noms que l’histoire lui donnera, l’exemple du trumpisme « en vraie grandeur » nous permet d’affirmer que l’entreprise politique extrême-droitière de ce premier XXIe siècle partage avec sa devancière du siècle précédent trois traits, trois ressorts essentiels, qui s’articulent et constituent ensemble une mécanique et une méthode.
1° Elle électrise, rend captif par l’amour, existe par la mobilisation d’une base de soutiens fanatisés.
2° Elle vise à faire peur, se nourrit de ce sentiment qui tétanise non seulement ses cibles naturelles, mais aussi les acteurs sociaux les plus susceptibles de lui opposer quelque résistance.
3° Elle prospère de l’apathie, de l’indifférence relatives des catégories de population qui à tort ou à raison ne se pensent pas concernées par ses mots et par ses actes.
Ce sont ces trois ressorts combinés qui organisent l’écrasement de la société et, présentement, de toute une partie du monde.
Mais deux autres traits propres à ce régime de pouvoir, et tout à fait remarquables, devraient nous aider à sortir de la zone des faits pour atteindre à celle des conjectures. Nous retrouvons ici les incohérences, les contradictions inhérentes aux doctrines en apparence même les plus solides, lorsque celles-ci se pensent comme des échappatoires.
Le premier de ces traits est une irrationnalité profonde, consubstantielle à tout projet fasciste ou fascistoïde dans sa dimension messianique, eschatologique, de création d’un monde affranchi du réel et de ses contingences et libéré des contraintes de l’histoire – l’Amérique MAGA dominant à nouveau la planète, la conquête de Mars, le retour de la suprématie blanche et masculine. Une irrationnalité consubstantielle également à toute entreprise fondée sur la relation charismatique entre un leader, ses obligés et sa base fanatisée.
La brutalité ne peut tenir lieu d’organisation et, sous couvert d’efficacité, l’antibureaucratisme trumpien (mis en œuvre par le DOGE), tout comme en son temps la bureaucratie fasciste, ne pourra produire que du chaos, au niveau national comme mondial. Le gel de dizaines de milliards de dollars dès après l’investiture et ses effets sur un grand nombre d’agents économiques – les agriculteurs, notamment – en est un exemple probant. Mais on peut aussi penser aux conséquences probables sur la santé et l’environnement de la suppression sèche de milliers de données, pages web et autres programmes de recherche dont tel mot clef a révélé qu’ils ne cadraient pas avec la novlangue et la novpensée trumpienne – masculiniste, suprémaciste, extractiviste – et, bien sûr, au sort fait à l’USAID. Il se peut que ces cas se multiplient à mesure que, pour l’amour du chef, les acteurs du trumpisme entreront en concurrence les uns avec les autres – nous renvoyons ici aux écrits de Ian Kershaw sur le nazisme.
Le second trait est l’indignation que ce régime de pouvoir ne peut que faire naître et alimenter, d’abord dans des sphères restreintes de la population, les premières visées, puis, par cercles concentriques, à mesure que l’irrationalité fait croître le chaos, dans d’autres, plus larges. Il devrait à cet égard être possible de former l’hypothèse – et de formuler l’espérance – que les initiatives brutales et désordonnées lancées tous azimuts par l’administration Trump 2 propageront bientôt l’indignation au-delà de ses sphères initiales, allumeront d’autres foyers, généreront des coalitions d’indignés. Et que cette indignation, devenue esprit de révolte, de résistance et de lutte, rognera à force sur la peur, sur l’indifférence, et pourquoi pas sur l’amour.
Aux premières semaines d’une ère nouvelle et tragique, nous sommes encore loin du compte. Pourtant, ce lundi 17 février, dans une centaine de villes des États-Unis, des manifestants se sont rassemblés pour dire « Pas de monarchie en Amérique »,
crier « Halte au coup d’État » et conspuer un « Felon » Musk visiblement décidé à prendre rang dans la longue liste des
« mauvais conseillers » qui finirent mal et déclenchèrent parfois les révolutions passées – rappelons-nous l’exemple de Strafford.
Quelques milliers de protestataires dans un pays qui mit, il y a trois mois à peine, plus de 70 millions de bulletins Trump dans l’urne, ce ne peut certes être qu’un timide prélude, si toutefois c’est le commencement de quelque chose. Reste que, de la même manière que l’élection funeste de novembre 2024 nous montre la voie à ne pas suivre, la révolte qui gronde déjà chez de nombreux·ses Américain·es nous montre ce à quoi il nous faut nous préparer pour l’avenir le plus proche. Là-bas comme ici, le choc sera rude, très rude, et l’on voit mal, au point où nous sommes du pourrissement de nos institutions politiques, qu’il soit encore possible de ne pas en passer par là.