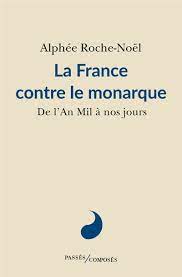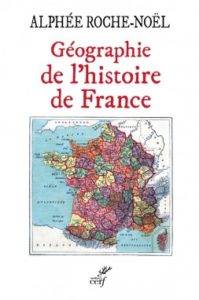Il est des moments où le réel rattrape les principes et les met à l’épreuve. La prise de pouvoir de Trump, à l’occasion de son second mandat, fut de ceux-là.
Depuis une dizaine de mois, pour la première fois en près d’un siècle, nous pouvons assister in concreto à ce que nous avaient appris nos manuels scolaires des prémices de l’installation, en régime libéral, d’un mouvement fascistoïde – c’est-à-dire d’un mouvement animé par un projet de régénération identitaire (raciste, nationaliste, masculiniste, théologique – tout cela cohabite dans le Maga), en opposition à l’idée de société comme communauté de droit.
Et ceci se produit dans la plus ancienne république au monde, celle-là même qui se trouve aussi – en apparence, tout au moins – en être la première puissance économique et militaire.
Au point où nous sommes, l’histoire ne nous dit pas si ces premiers signes aboutiront à une subversion complète de l’ordre républicain. Car d’autres signes, qu’il s’agit de regarder avec prudence, nous montrent que la société civile vit encore, que l’opposition se réveille, que les institutions conservent des anticorps et peut-être également que la dimension fasciste du trumpisme est insuffisamment homogène ou résolue pour peser sur le cours des événements d’une manière telle que le changement de régime apparaîtrait indiscutable ou inéluctable.
Cependant, cette même histoire nous met en garde, nous avertit que les choses pourraient désormais aller très vite.
La mise en œuvre d’un projet fascistoïde
Quoique chaotique dans son déroulement, le phénomène est en effet, par l’esprit qui s’en dégage, d’une grande clarté.
Il n’est pas inutile d’en rappeler les principaux aspects,
1° à l’intérieur des États-Unis :
– confusion des formes et des organes (gouvernement fédéral/famille Trump et sa clientèle/mouvement Maga/Big Tech/Great Old Party/mouvement charismatique),
– démantèlement méthodique de l’administration,
– mobilisation de l’appareil sécuritaire à des fins non conformes à ses buts et selon des modalités qui peuvent faire craindre un coup de force,
– persécution de magistrats et avocats,
– diabolisation de l’opposition,
– mépris pour les décisions de justice,
– empiètement sur le législatif,
– redécoupage de la carte électorale au profit du parti au pouvoir,
– détournement de lois,
– pressions sur la presse et l’enseignement supérieur,
– diffusion à grande échelle de fausses informations,
– atteinte à la liberté scientifique, à la liberté d’expression, attaques contre les connaissances,
– discrimination des minorités de genre,
– chasse aux étrangers,
– abrogation de mesures de protection de l’environnement,
– remise en cause de mécanismes de protection sociale,
– etc.,
2° comme à l’extérieur de ce pays :
– normalisation à grande échelle des conflits d’intérêts entre diplomatie, business, religion,
– destruction des moyens de l’assistance et de l’influence étatsunienne,
– retrait de traités conçus comme nécessaires au bien commun de la communauté internationale (armes, environnement),
– renversement des alliances géopolitiques traditionnelles,
– chantage aux pays alliés et ingérence pour y faire advenir ou y maintenir des mouvements « frères »,
– menaces d’annexion de pays alliés ou de territoires leur appartenant,
– menaces d’invasion de pays dans la sphère d’influence américaine et officialisation d’actions de déstabilisation conduites par la CIA,
– etc.
S’il n’a rien d’un « coup de tonnerre dans un ciel serein », ce phénomène nous donne cependant à voir, avec la brutale franchise de l’expérience historique, ce qu’il y a un an à peine nous pouvions seulement nous représenter comme une pente certaine et un avenir probable.
Il clarifie ainsi les formes, les lignes, les limites de concepts que la simple réflexion in abstracto ne permet pas toujours de distinguer comme il le faudrait : qu’est-ce qu’une gauche, qu’est-ce qu’un centre, qu’est-ce qu’une droite, qu’est-ce qu’un fascisme, qu’est-ce que l’état de droit.
Il nous montre également : 1° qu’une république est mortelle, 2° comment une république peut mourir, 3° ce que nous pouvons en redouter, 4° ce qu’il y aurait à en regretter.
Ce faisant, tout en nous posant à nouveaux frais la question :
– que faire ? (pour détourner le probable, pour rouvrir le possible),
il nous pose d’une manière tout à fait inédite la question préalable :
– que penser ? (non pas comme un problème spéculatif ou rhétorique, mais comme une urgence vitale, sous la menace d’une catastrophe imminente).
République, démocratie, socialisme : de l’importance de définir les termes
Parce que ce phénomène prend la forme, de ce côté-là comme de ce côté-ci de l’Atlantique, d’un projet plus ou moins larvé, plus ou moins déclaré de destruction des institutions républicaines, démocratiques et sociales, nous pouvons saisir d’intuition que la réponse à cette question brûlante a quelque chose à voir avec la signification fondamentale de ces institutions.
Les mots république et démocratie, auxquels je crois nécessaire d’ajouter le mot socialisme – car si tout social n’est pas socialisme, le socialisme n’en est pas moins la dernière instance du social, sa prise en main par la société elle-même, à travers les institutions dont elle s’est dotées –, ces mots, donc, ont reçu au fil du temps une multiplicité de définitions, parfois fort différentes, selon qu’ils furent mobilisés dans tel ou tel contexte. Ils furent ainsi recouverts de sédiments qui finirent par les rendre, au moment où nous pourrions supposer que nous en avons le plus besoin, de moins en moins lisibles.
Par ailleurs, les concepts auxquels ils renvoient semblent le plus souvent abordés comme des entités séparées, voire mutuellement exclusives, plutôt qu’à travers l’ordre et l’articulation auxquels nous invite l’histoire des sociétés, de la Renaissance au XIXe siècle.
C’est de cet ordre et de cette articulation qu’il me paraît utile et justifié de partir, en appelant :
– république, une communauté de droit dont les membres sont égaux devant la loi ;
– démocratie, une république dont les membres ont part égale dans la direction de la communauté ;
– socialisme, une démocratie organisée « de chacun·e selon ses moyens, à chacun·e selon ses besoins ».
(Tout en ayant conscience du caractère incomplètement satisfaisant de cette démarche, je crois nécessaire d’y inclure l’écologie, car la règle selon laquelle il convient de ne pas prélever à la nature plus que ce qu’elle est en capacité de donner me semble pouvoir être contenue dans ce dernier concept, dès lors que le vivant non-humain n’est pas réifié.)
Telles qu’elles se présentent ici, ces acceptions peuvent aider à penser l’histoire.
C’est en effet à travers cette subsomption enchaînée qu’il nous faut les considérer : comme procédant nécessairement l’une de l’autre, sans que la deuxième puisse en aucun cas être tenue pour la suite nécessaire de la première, ni la troisième de la deuxième.
En d’autres termes : si toute république n’est pas démocratique et si toute démocratie n’est pas socialiste, le socialisme ne peut être hors de la démocratie, ni la démocratie hors de la république, sauf à se nier eux-mêmes (comme font les formes « socialiste-autoritaire » et « démocratique-plébiscitaire » qui ne sont, pour la première, nullement socialiste et, pour la seconde, en aucun cas démocratique).
On le comprendra mieux encore en examinant cet enchaînement à partir des définitions que nous avons posées.
En effet, il ne paraît guère possible d’imaginer une société « de chacun·e selon ses moyens, à chacun·e selon ses besoins » dont les membres n’auraient pas part égale à sa direction, ni une société dont les membres auraient part égale à sa direction, si tous n’avaient pas au préalable été reconnus comme égaux devant la loi dans une communauté de droit.
Sur ces bases, il doit être possible et utile d’affirmer que le concept de république pose les conditions mêmes de la vie en commun dont les concepts de démocratie et de socialisme peuvent apparaître respectivement comme les prolongements les plus souhaitables du point de vue des modalités et de la finalité.
De sorte que, du point de vue des droits, une ligne puisse être tracée entre ces trois concepts, du cadre au contenu et du droit le plus formel aux droits les plus réels.
Faut-il préciser que ces concepts sont ici proposés comme des idéaltypes ? Que, dans la vie concrète, ils n’existent pas « à l’état pur » ? Que comme idéaux, ils peuvent être poursuivis, mais jamais atteints ?
Pour mieux le comprendre et lever toute ambiguïté quant aux applications qu’ils sont susceptibles de recevoir dans la vie concrète, le mieux est encore de prendre un exemple parlant.
Ainsi, depuis 1946, la société politique « France » se décrit et se proclame, dans sa constitution, comme « une république […] démocratique et sociale ».
Une telle déclaration de principe pourrait aussi bien n’avoir aucune consistance. Il est bien des régimes où des revendications du même type ne se situent pas seulement dans un certain écart avec le réel, mais dans un rapport de contradiction tel qu’elles apparaissent nulles et non avenues. En toute rigueur, ce n’est pas – encore – le cas de la France d’aujourd’hui, malgré de remarquables et périlleux reculs, depuis dix à trente ans, impulsés par l’ordre néolibéral et inspirés par la dynamique réactionnaire. Il doit nous être possible de le vérifier pour chacune de ces affirmations en les questionnant successivement à partir de nos propres définitions.
– La société politique « France » est-elle une république ? Fondée sur les principes du droit et de l’égalité des personnes devant la loi, elle possède encore des titres sérieux à faire valoir dans ce domaine.
– Est-elle démocratique ? Reposant sur la participation formellement égalitaire des citoyennes et citoyens à la direction de la société, ses prétentions à cet égard ne sont pas sans fondement, bien que l’intervalle entre le formel et le réel ouvre un immense horizon d’attente, et se soit même accru au cours de la période récente.
– Est-elle enfin, sociale ? Comme « fédération de services publics », elle se manifeste en tout cas sous la forme d’institutions, qui, bien qu’elles aient été et demeurent durement attaquées par tous les gouvernements depuis une trentaine d’années, lui conservent cette coloration et cette vocation.
Le cadre commun des combats démocratiques et sociaux
On le voit, si ces concepts, ainsi définis, ne sont pas destinés à décrire le réel, ils peuvent cependant nous aider à le penser :
1° D’abord en nous indiquant la direction d’une société souhaitable et toujours en devenir.
2° Ensuite, en nous désignant la république comme le cadre a priori des combats démocratiques et socialistes, en attaque comme en défense ; celui au sein duquel sont tous les droits conquis et à conquérir et hors duquel ils ne peuvent être.
Il me semble primordial de comprendre ce second point. Car si, comme démocrates et socialistes, nous observons (et non pas, « nous croyons ») qu’il ne saurait y avoir de république sans institutions sociales fortes, il a pu nous échapper, dans le tumulte de l’histoire récente, qu’il ne saurait non plus y avoir de socialisme sans république.
Au passage, on peut observer qu’il n’appartient à nulle autre forme de pensée politique, autant qu’aux socialistes, de tenir ainsi « les deux bouts de la chaîne » : d’alerter d’un côté : « socialisme ou barbarie », comme de l’autre : « fascisme ou république ».
Contrairement à l’impression d’abstraction qu’elle pourrait donner au premier regard, cette approche se dévoile sous son aspect le plus concret dès lors qu’on la confronte à nouveau au phénomène qui nous l’a révélée comme une manière possible de penser le présent : l’accession au pouvoir d’un mouvement fascistoïde aux États-Unis d’Amérique.
Car, que font Trump et sa clique, sinon avec méthode, du moins avec une implacable résolution ? Ils s’attaquent au droit : à la « rule of law » à l’intérieur, au droit international à l’extérieur.
Et comment s’y attaquent-ils ? En testant, en discréditant, en tordant et en maltraitant la lettre et l’esprit du droit, ensemble avec les institutions et professionnels chargés d’en assurer l’effectivité.
Et pourquoi s’y attaquent-ils ? Tout autant parce que leur vision fantasmatique de la société est fondamentalement contraire au droit, que parce qu’il leur faut détruire le droit pour pouvoir donner corps à cette vision fantasmatique, l’assaut en règle qu’ils ont déclenché contre le droit pouvant en cela être compris comme étant à la fois consubstantiel à leur projet et préparatoire à sa mise en œuvre.
De ce basculement, de la manière dont il est opéré et se produit, il ne me semble donc pas hors de propos de déduire que l’alternative se pose à nous en ces termes : fascisme ou république.
Si nos sociétés politiques se divisent aujourd’hui entre des individus qui souscrivent ou se résignent au tournant fascistoïde et d’autres qui le refusent, alors la survie de ce morceau de société et, à travers lui, de l’ensemble des droits démocratiques et sociaux, dépend de ce qu’il saura ou non trouver, dans le concept de république, le cadre commun de ses combats.
Discernement ou confusion
La simple observation des faits, le rapprochement de ceux-ci avec les concepts et les principes, devraient disposer toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans ce cadre au compromis minimal qui se trouve en être la condition sine qua non.
Or, la possibilité même de ce compromis est de plus en plus ténue.
Si le premier « front républicain », en 2002, eut lieu spontanément, sans barguigner, le dernier en date, en 2024, ne se fit qu’au terme d’un processus dangereusement laborieux.
Les événements les plus récents témoignent de ce qu’il devient difficile de lui redonner vie et raison d’être, en particulier lorsqu’il s’agit d’éviter une accélération du calendrier électoral, dont pas une tête bien faite ne peut ignorer que l’issue la plus probable serait une notable progression de l’extrême droite, alors possiblement en capacité de gouverner avec la frange extrême de la droite.
Sans doute des discours spécieux longtemps rabâchés ont contribué à créer la confusion mentale et morale propice à cet état de choses : ainsi notamment de l’« arc républicain » de Macron, inventé pour diviser la gauche et lui permettre de se camper en « dernier rempart ».
Faire de Macron « le principal responsable de la montée de l’extrême droite », comme on l’entend parfois, est assurément un lieu commun absurde, masquant à la vue l’autonomie de la dynamique réactionnaire. Pour autant, il est un fait que, entiché de son pouvoir en trompe-l’œil, le macronisme œuvra avec constance à rendre impossible la construction d’un républicanisme efficace, ce qui eût supposé la prise en compte de la dimension démocratique et sociale du problème – superbement ignorée du mouvement des gilets jaunes à celui contre la réforme des retraites. Il est également un fait que le macronisme, comme le hollandisme et comme le sarkozysme avant lui, mais à une échelle inédite, accentua les tendances autoritaires d’un État insensiblement mis au service de la cause néolibérale.
Bien qu’à un degré incomparablement moindre, la gauche, cependant, ne peut être tenue comme n’ayant aucune part à la confusion ambiante. Ainsi, la stratégie populiste à laquelle adhère une partie de celle-ci – improprement qualifiée, pour cette raison même, de « radicale » –, n’a cessé, au cours des dernières années, d’« aplatir » le réel, et par là d’étouffer l’esprit de nuance qui en toute circonstance devrait nous conduire et à distinguer l’extrême droite de l’« extrême centre » et à en hiérarchiser les menaces. L’on en revient ici, de notre point de vue de républicain, démocrate et socialiste, à l’utilité de circonscrire et d’enchaîner ces concepts.
Quant à la droite « canal historique », devenue, de manière plus ou moins officielle, la supplétive de l’extrême droite, faut-il seulement la mentionner ici ? S’il demeure une fraction de ce camp qui puisse encore se dire à bon droit « républicaine », l’histoire récente ne l’a pas fait émerger comme telle.
Au total, dans un espace politique historiquement structuré et par la conception unitaire de l’État et par le principe majoritaire qui en découle, les visées stratégiques, les ambitions personnelles, les coups de billard à trois bandes ont empêché non seulement la construction, mais jusqu’à l’idée d’une défense républicaine efficace.
Il faudra voir à cet égard si d’autres sociétés politiques, menacées comme la nôtre par les mêmes dangers, mais organisées différemment, y résisteront mieux.
La conclusion de ce propos ne saurait cependant relever d’un solutionnisme de mauvais aloi – « il faudrait… » – ni, moins encore, d’un prophétisme déplorateur – « il aurait fallu… ».
Elle se limitera à inviter au discernement. Car sans discernement il ne peut y avoir de pensée, sans pensée, de jugement et, sans jugement, d’action conforme à ce que nos principes nous permettent de définir, dans le possible, comme le souhaitable et le juste.