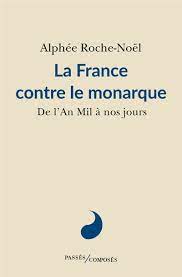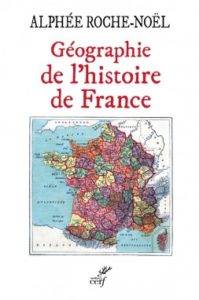De la tragédie à la farce : Macron/Sarah Bernhardt dans le rôle de Hamlet.
Refuser l’exégèse de la parole présidentielle est à la fois une gageure et un exercice de salubrité démocratique.
Une gageure, parce que Macron n’avait pas encore lancé son « vive la République, vive la France », ce dimanche 14 juin au soir, que, déjà, son propos était devenu le point focal du débat public.
Un exercice de salubrité démocratique, parce que depuis de trop nombreux lustres, le peuple est constamment ramené dans l’âge puéril par cette voix tutélaire, comme sortie de la crypte de Saint-Denis, et qui semble lui dire :
« Assieds-toi, mon enfant, et écoute-moi sagement. »
Écouter ? Mais pour entendre quoi ? Rien hier de suffisamment précis et circonstancié sur ce qui intéressait urgemment la société et aurait dû être présenté par le premier ministre : les conditions de la nouvelle phase du déconfinement. Rien non plus sur le reste ; Jupiter ayant quitté les cimes lumineuses de l’Olympe pour l’obscurité de la grotte de Delphes, distillant ses présages à la manière d’une Pythie, il nous faudra attendre le 14 juillet, jadis fête de la Fédération, désormais fête de la Révélation, pour savoir à quelle sauce nous serons mangés. Triste sort que celui d’un peuple coincé entre un homme et son destin, réduit, comme le spectateur d’une tragédie shakespearienne, à écouter les soliloques du pouvoir impuissant !
Refuser l’exégèse, donc, non pas pour faire comme si le « chef de l’État », dans sa version gaullienne, abâtardie par le passage au quinquennat et par les aventures grotesques des deux dernières décennies, n’était pas une réalité institutionnelle écrasante, mais pour montrer l’impasse où se trouve ce régime providentialiste, confronté à la plus grave crise de son histoire.
Impasse, car, comme Macron lui-même l’a reconnu : la société s’est très bien débrouillée sans lui pendant la crise sanitaire.
Impasse, aussi, car cette même société aspire à une réforme profonde des institutions, ou plus exactement à une révolution citoyenne, impulsée par elle, qui rendrait à la République et sa légitimité populaire et sa vocation démocratique et sociale. Le référendum d’initiative citoyenne (RIC) en serait la clef de voûte.
Impasse, enfin, parce qu’en remettant les clefs au président, donc à la cause principale du problème démocratique, l’actuelle constitution pose des obstacles au lieu de dégager la voie.
Quelles sont, alors, les options à la main du césar ? Depuis plusieurs semaines déjà la presse les égrène comme autant d’expédients qui lui permettraient de se « relancer » : la dissolution de la soi-disant assemblée nationale, le référendum-plébiscite, ou le remaniement, qui n’est jamais qu’un changement d’acteurs.
Passons sur le remaniement : il ne dupe plus personne depuis que Louis XVI a renvoyé et rappelé Necker. De toutes les traditions politiciennes, celle-ci, ourdie dans le secret des palais « républicains », est sans aucun doute la moins démocratique. « Là où une zone d’ombre échappe au regard du peuple, il n’y a pas de République », a écrit Mitterrand. Formule paradoxale sous la plume du futur sphinx de la 5e, mais qui résume admirablement un principe régulièrement bafoué par les mercatos ministériels. Passons également sur le référendum d’initiative présidentielle, de tradition impériale plus que républicaine. Quant à la dissolution… dans le cas actuel, elle ne serait pas dépourvue d’intérêt, mais quand bien même elle déboucherait sur l’élection d’une majorité résolue à adopter des mesures sociales et écologiques dignes de ce nom, elle ne répondrait que partiellement aux vœux populaires, qui portent à la fois sur la politique elle-même et sur les conditions de l’exercice démocratique. Or, si l’initiative d’une révision appartient « concurremment au président de la République et aux parlementaires »**, cette dernière voie paraît, pour des raisons de fond comme de forme, difficilement praticable.
Dans leur immense sagesse, les pères de la 5e s’étaient toutefois tus sur un ultime et déraisonnable artifice, que l’hybris propre aux présidents quinquennaux, et singulièrement à l’actuel, vient de faire surgir du silence : la démission-réélection.
Ainsi un article du Figaro racontait la semaine passée que le président lui-même aurait évoqué cette possibilité lors d’une récente réunion de ses « donateurs londoniens », se disant prêt à « prendre son risque ». Folie de quiconque croirait pouvoir tordre à son profit les institutions ! Mais ne fallait-il pas s’y attendre dès le soir du 7 mai 2017, en voyant Sôter Macron traverser la cour du palais des rois de France et exulter tel Akhenaton devant sa pyramide translucide ? Puis, quelques semaines plus tard, parader sur son command-car, se rêvant chef effectif des armées et méditant le limogeage de son généralissime ? Que de symboles nous avons moqués, sans en comprendre l’augure!
Dans les faits, une telle opération serait une sorte de coup d’État, puisque aucune autre formation politique que celle qui sert à la fois de pavois et de paillasson à Emmanuel Macron ne pourrait, dans le temps imparti par la Constitution***, se mettre en ordre de bataille.
Si cette hypothèse, démentie aussi sec par le Palais, devait néanmoins survenir, il faudrait en tout cas la refuser en bloc : acter la démission du « chef de l’État », s’opposer à ce qu’il candidate à sa propre réélection et, constatant la mort cérébrale de la 5e, réclamer enfin la Constituante qui seule pourra sortir la République de l’ornière, et la remettre sur la route de l’intérêt général.
Dans tous les cas, n’est-ce pas l’objectif qu’il faut viser ?
*Le Coup d’État permanent, Plon, 1964.
**Art. 89, de la Constitution.
***L’art. 7 prévoit que le 1er tour du scrutin doit avoir lieu entre 20 et 35 jours après le constat de la vacance présidentielle.