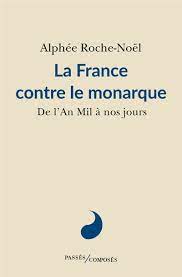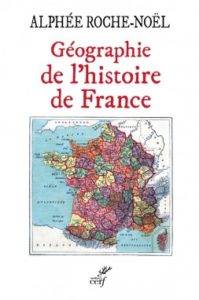Voilà cinq jours que la gauche ergote et se divise sur le point de savoir s’il faut rejoindre la marche du 10 novembre pour dire « non » à l’islamophobie. L’appel à se rassembler suscite des questionnements sans fin et des scrupules jamais observés. On en discute les termes, les signataires, les mots d’ordre ; on s’avance, on s’interroge, on se rétracte. Au total : certains iront, certains feront bande à part, d’autres resteront chez eux. Une seule chose est sûre dans ce vaste embrouillamini : si l’on examinait aussi minutieusement les motifs et les parties prenantes de toutes les mobilisations avant d’y participer, il n’y aurait plus grand monde dans la rue pour réfuter le racisme et toutes ses abjectes variantes.
Pour ma part, je marcherai dimanche : pour la fraternité, contre la haine. Je marcherai dans l’espoir de dissiper l’atmosphère étouffante instaurée par une poignée de boutefeux. Cela fait-il de moi l’idiot utile des promoteurs de l’islam politique ? Je crois justement qu’il ne faut pas leur laisser cet espace libre ; je crois aussi que détourner le regard servirait une extrême droite qui œuvre à nous faire voir partout l’islamisme.
Marcher contre l’islamophobie n’est en aucun cas renoncer à la critique de la religion, comme d’ailleurs de toute tradition. Son exercice est la condition sine qua non de la liberté et l’on connaît trop le rôle des Églises, à croix, à croissant ou à étoile, dans la perpétuation du patriarcat et de la hiérarchie des classes, pour ne pas voir les dangers qu’il y aurait à les laisser reconstituer leur emprise sur la société. J’affirme cependant que l’on peut aussi, sans se déjuger, considérer la question religieuse avec une modération généralement absente des proclamations d’estrade : admettre simplement que certains de nos frères et sœurs humains cherchent dans la foi soit le sens caché du monde, soit un secours moral face à l’âpreté de la vie, que cette conviction ne s’extirpera ni par la force, ni par l’admonestation raisonnable, et que la dédaigner serait en faire don aux rigoristes. Notons au passage que la religion opium du peuple n’est pas vouée à entraver en toutes circonstances un progrès social qu’il lui est même parfois arrivé d’accompagner : du bas clergé de 1789 aux prêtres ouvriers des temps industriels. N’oublions pas surtout que, se rendant à cette imparable nécessité de la tolérance sans laquelle il est impossible de vivre ensemble, les rédacteurs de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ont écrit que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses ».
Mais on ferait fausse route en se focalisant sur le religieux, c’est-à-dire sur le signe, quand c’est le social qui est en cause, c’est-à-dire le fait. On suivrait ainsi les identitaires de tous bords, perinde ac cadaver, jusqu’au bord de la falaise d’où ils veulent nous précipiter.
Sans doute cette approche permettrait-elle d’envisager différemment la question qui nous occupe. Car, qui sont, en définitive, les cibles des déclarations stigmatisantes de MM Zemmour et consorts et des violences qu’elles libèrent ? : les filles et les fils des ouvriers employés jadis par le capitalisme d’État pour faire tourner les usines des Trente Glorieuses, eux-mêmes à la merci d’un capitalisme échevelé créateur de chômage et de précarité ; les enfants, désormais adultes, d’une république qui les a constamment méprisés et dont les ministres pensent encore être entendus lorsqu’ils prodiguent leurs leçons de morale laïque. Plus que jamais il faut convenir que l’émancipation ne se décrète pas mais se construit. Et de ce point de vue, humblement reconnaître que nous construisons sur des ruines – les ruines laissées par la colonisation, la relégation urbaine et l’atomisation néolibérale. C’est la raison pour laquelle avant tout autre question se pose me semble-t-il celle de la méthode pour faire front commun.
En revendiquant leur part dans la cité, les gilets jaunes ont fait naître un formidable espoir de rassemblement des classes moyennes et des classes populaires. Des rapprochements se sont opérés entre la France périphérique et celle des banlieues, que les hésitations des derniers jours risquent de faire faseyer. Entre ceux qui revendiquent des idéaux de progrès social et humain et ceux qui sont désignés comme les boucs émissaires d’une société dont ils avaient été écartés dès l’origine, il y a une solidarité d’intérêts et il doit y avoir une solidarité d’action. Ce serait là la meilleure réponse à ceux qui, artisans ou héritiers spirituels des politiques de destruction des solidarités républicaines, sont passés maîtres dans l’application de l’adage « diviser pour mieux régner ».