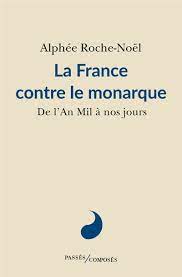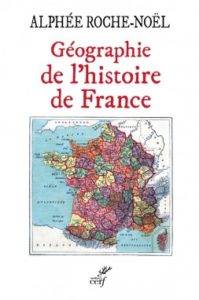Comme je l’ai écrit ici, je suis né dans l’île de la Cité, et j’ai grandi auprès des eaux de la Seine, entre le pont Neuf et le pont de l’Archevêché.
J’ai joué, enfant, à l’ombre de Notre-Dame. Lorsque, adolescent, j’eus quitté ses parages, elle resta mon repère. Bien des années plus tard, elle n’a pas cessé de l’être.
De la Ville elle m’est toujours apparue comme le décor le plus fascinant, le plus poétique, le plus écrasant de grandeur. De la rue du Renard, du quai de Montebello, des ponts, de loin en loin, dans tous les ciels, dans toutes les lumières et de l’aube au couchant, je m’émerveille de la voir surgir, dans le méandre du fleuve : vaisseau en partance, rêve gothique, mirage vénitien.
Elle a hanté mes nuits, construit la géographie de mes songes, jalonné mes promenades. Nous devions y retourner bientôt, en ce printemps commençant, aller la deviner derrière les trembles et les platanes, débattre du point de savoir si nous en aimions mieux les façades latérales ou le chevet. Au lieu de cela, nous irons, le coeur lourd, découvrir ce qu’il en reste.
Des hauteurs de Ménilmontant, je l’ai vue s’envoler, fumée blanche dans le ciel bleu.
Pour les Parisiens, pour les Français, Notre-Dame était, est encore peut-être, l’un de ces rares lieux et monuments où se mêlent le moi et le nous, le sensible et l’intelligible. La mémoire nationale, la mémoire humaine l’ont sécularisée, rendue accessible à tout un chacun, faisant d’un signe des temps, dans la chrétienté médiévale, la pierre d’angle d’une singularité universelle, dans la France républicaine.
Sa destruction partielle n’est pas une apocalypse, mais une invitation à vivre et se souvenir. À concevoir aussi le patrimoine non pas comme une identité figée, mais comme une fraternité mouvante.